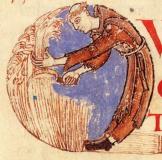SĂ©bastien MOUREAU1
Miroir de lâĂ©tat des connaissances au milieu du XIIIe siĂšcle, lâĆuvre encyclopĂ©dique de Vincent de Beauvais ne cesse dâĂȘtre Ă©tudiĂ©e depuis des annĂ©es par les chercheurs. Mais lâabondance dâinformations et de domaines couverts par le dominicain est loin dâavoir Ă©tĂ© Ă©puisĂ©e. Lâalchimie, science encore jeune au XIIIe siĂšcle, fait partie de ces champs de connaissance. Elle est introduite en Occident latin lors du mouvement des traductions arabo-latines des XIIe et XIIIe siĂšcles. On considĂšre gĂ©nĂ©ralement comme limite la premiĂšre traduction latine dâun traitĂ© arabe alchimique complet qui soit datĂ©e, la traduction du Liber de compositione alchimiae, attribuĂ© Ă lâalchimiste lĂ©gendaire Morien, rĂ©alisĂ©e en 1144 par Robert de Chester ; cependant, cette Ă©tape est un terme symbolique, car la plupart des traductions de textes alchimiques ne sont pas datĂ©es2. Mais lâart de la transmutation passionne rapidement les Occidentaux, et Vincent de Beauvais lui accorde une place considĂ©rable dans son Ćuvre, se faisant le tĂ©moin du statut de lâalchimie au XIIIe siĂšcle. Cependant, si quelques Ă©tudes ont Ă©tĂ© produites Ă ce sujet3, elles nâont rien de systĂ©matique. En examinant toutes les citations relatives Ă ce domaine dans le Speculum maius, je tends Ă combler cette lacune en clarifiant les opinions Ă©mises pour apporter de nouveaux Ă©lĂ©ments de rĂ©flexion. Cette Ă©tude se focalise ainsi sur lâidentification et lâanalyse des sources alchimiques du Speculum maius de Vincent de Beauvais ; elle porte principalement sur la version trifaria (terminĂ©e vers 1259), dans laquelle lâalchimie est abordĂ©e abondamment, mais sâattarde Ă©galement quelque peu sur la version bifaria (antĂ©rieure Ă 1244) ; le but nâest pas de dĂ©finir une doctrine des mĂ©taux chez Vincent de Beauvais, exercice quelque peu artificiel et souvent pĂ©rilleux, ni de cerner lâopinion de Vincent de Beauvais sur lâalchimie, ce qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© fait4. Mon intention est aussi de proposer aux chercheurs un outil prĂ©cieux en annexe : la comparaison intĂ©grale des extraits relatifs Ă lâalchimie du Speculum naturale (= SN), du Speculum doctrinale (= SD) et de leurs sources identifiĂ©es5. Ces outils ont Ă©tĂ© construits grĂące au corpus Sourcencyme (Sources des encyclopĂ©dies mĂ©diĂ©vales) mis en Ćuvre par Isabelle Draelants Ă lâAtelier Vincent de Beauvais du Centre de MĂ©diĂ©vistique Jean-Schneider (ERL 7229) de lâUniversitĂ© de Lorraine6, et permettent des Ă©tudes analytiques de lâutilisation des sources alchimiques dans le Speculum maius.
AprĂšs un rapide Ă©tat de la question, les mĂ©thodes de dĂ©limitation du corpus et dâidentification des sources sont prĂ©sentĂ©es. Ensuite vient lâexamen systĂ©matique de chaque autoritĂ© citĂ©e et lâutilisation quâen font Vincent de Beauvais et ses frĂšres7 ; ces autoritĂ©s sont classĂ©es selon le type de collecte puis selon lâordre de longueur des citations, en ordre de frĂ©quence dĂ©croissante, Ă partir de lâautoritĂ© la plus citĂ©e (Ă lâexception de lâActor, placĂ© Ă la fin de lâarticle).
Introduction
Ătat de la question
La premiĂšre Ă©tude de lâalchimie chez Vincent de Beauvais est celle de Marcellin Berthelot8. Dans son ouvrage sur lâhistoire de la chimie au Moyen Ăge, le cĂ©lĂšbre chimiste consacre quelques pages au Speculum maius, dans lesquelles il sâintĂ©resse avant tout Ă lâopinion de Vincent de Beauvais lui-mĂȘme ainsi quâau contenu des citations. Il y prĂ©sente un bon rĂ©sumĂ© des passages du Speculum naturale sur lâalchimie. Mais lâessai de dĂ©gager une doctrine propre Ă Vincent de Beauvais tourne vite court ; Berthelot constate en effet que, si les textes citĂ©s par Vincent de Beauvais prĂŽnent le plus souvent les mĂȘmes idĂ©es, ils diffĂšrent cependant en ce qui concerne les dĂ©tails, ce qui rend incohĂ©rent le tout. On observe quelques gĂ©nĂ©ralisations, ainsi que quelques erreurs historiques : Berthelot voit en Vincent de Beauvais le tĂ©moin de la connaissance des alchimistes de son temps, et prĂŽne lâutilisation du Speculum maius pour dater le contenu des traitĂ©s alchimiques, alors que Vincent de Beauvais nâutilise quâun certain nombre de traitĂ©s, et tĂ©moigne uniquement de la connaissance de lâalchimie par les non-alchimistes de son Ă©poque.
En 1944, Pauline Aiken sâintĂ©resse secondairement Ă lâalchimie chez Vincent de Beauvais dans son article Vincent of Beauvais and Chaucerâs Knowledge of Alchemy9. Cet article consacrĂ© principalement Ă Chaucer prĂ©sente quelques imperfections dans la mesure oĂč Aiken tente de dĂ©finir la doctrine alchimique de Vincent comme si câĂ©tait une composition propre, sans tenir compte du caractĂšre encyclopĂ©dique du Speculum maius, et trahit un manque de connaissance des textes alchimiques (par exemple, le De anima attribuĂ© Ă Avicenne qui est citĂ© par Vincent de Beauvais nâest en rien le De anima authentique dâAvicenne).
En 1976, Chiara Crisciani prĂ©sente une brĂšve Ă©tude sur les liens entre lâalchimie et les dominicains au XIIIe siĂšcle10. Elle tire dâintĂ©ressantes conclusions sur la façon dont Vincent de Beauvais considĂšre lâalchimie comme un art mĂ©canique.
Dans le mĂȘme ordre dâidĂ©es, Jean-Marc Mandosio publie en 1993 un article consacrĂ© Ă lâalchimie dans la classification des sciences et des arts Ă la Renaissance11. Il propose au dĂ©but de son article une brĂšve Ă©tude de la place de lâalchimie dans les classifications du XIIIe siĂšcle, et y souligne les opinions de Vincent de Beauvais. Ce dernier se fonde sur les classifications dâHugues de Saint-Victor et de Richard de Saint-Victor, et considĂšre lâalchimie comme un art mĂ©canique, câest-Ă -dire relevant des arts « qui, dâaprĂšs les dĂ©finitions courantes de la science, ne sâefforcent pas de comprendre en le thĂ©orisant le âpourquoiâ des choses »12. Ainsi, Vincent de Beauvais tient lâalchimie pour un art qui se limite Ă de simples opĂ©rations manuelles, une pratique sans thĂ©orie, une technique qui manipule des forces sans chercher Ă les comprendre. Il en fait un art subordonnĂ© Ă dâautres (mĂ©decine, mĂ©tallurgie). Il ne nie cependant pas la possibilitĂ© de lâexistence dâune thĂ©orie des arts mĂ©caniques, mais elle est dâune certaine maniĂšre extĂ©rieure Ă eux, les artisans ne la possĂšdent pas13.
En 1991, William Newman se penche briĂšvement sur la place de Vincent de Beauvais dans lâ« Alchemical debate » du XIIIe siĂšcle concernant la possibilitĂ© de la transmutation des espĂšces14.
Câest en 1998 que paraĂźt un article plus spĂ©cifiquement consacrĂ© Ă lâalchimie chez Vincent de Beauvais et dâautres encyclopĂ©distes du XIIIe siĂšcle, publiĂ© par Marie Claude DĂ©prez-Masson15. Il constitue une bonne contribution Ă la question ; son intĂ©rĂȘt principal rĂ©side dans les rĂ©sumĂ©s fiables de la structure des passages du Speculum maius sur lâalchimie (p. 133-135), et une esquisse de lâĂ©volution entre la version bifaria du Speculum maius et la version trifaria (p. 136-142). En revanche, lâidentification est laissĂ©e de cĂŽtĂ©, et lâĂ©tude comporte plusieurs erreurs : DĂ©prez-Masson considĂšre comme primaires des sources internes, par exemple lâArmenides qui est en rĂ©alitĂ© une citation du De aluminibus et salibus qui contient elle-mĂȘme une phrase attribuĂ©e Ă Armenides. En consĂ©quence, les conclusions se rĂ©vĂšlent douteuses voire erronĂ©es, mais peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©es par les articles de Chiara Crisciani et Jean-Marc Mandosio.
Dans son ouvrage Scolastique et Alchimie publiĂ© en 200916, Sylvain Matton offre aux pages 739-764 le texte des chapitres 105-133 du livre XI du Speculum doctrinale. Il utilise lâĂ©dition de 1591 de Venise, et propose en apparat les leçons des extraits correspondants du Speculum naturale.
RĂ©cemment, Jean-Marc Mandosio publie un article sur lâacier dans lequel il analyse plusieurs passages du Speculum maius de Vincent de Beauvais17 et les met en contraste avec les descriptions de lâacier dans le Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© et le De anima alchimique du Pseudo-Avicenne, entre autres textes.
Le dossier sur lâalchimie chez Vincent de Beauvais prĂ©sentĂ© ici nâest pas la premiĂšre Ă©tude exhaustive dâun domaine du savoir dans lâencyclopĂ©die du dominicain : la logique a fait lâobjet de la thĂšse de Serge Lusignan, la mĂ©decine a Ă©tĂ© analysĂ©e par Stefan Schuler, et le droit par Mario Cardinale18, mais aucun nâa offert une identification complĂšte des sources employĂ©es par Vincent de Beauvais.
Lâalchimie chez Vincent de Beauvais
Sur les citations consacrĂ©es Ă lâalchimie dans la version bifaria du Speculum maius, nous connaissons peu de choses. On trouve quelques passages sur la minĂ©ralogie au livre V, qui concerne lâĆuvre du troisiĂšme jour de la crĂ©ation (Quintus agit de inicio operis tercie diei id est de dispositione partium inferiorum huius mundi et habet (CXXXIII) capitula)19. On sait Ă©galement que le livre XXV, perdu Ă ce jour, Ă©tait consacrĂ© aux arts mĂ©caniques (De mechanica et eius speciebus) ; il contenait peut-ĂȘtre des donnĂ©es sur lâalchimie (les manuscrits de la bifaria conservĂ©s ne couvrent que les livres I Ă VIII).
Dans la version trifaria du Speculum maius, lâalchimie est principalement abordĂ©e dans deux parties. Dans le Speculum naturale, au livre VII, consacrĂ© Ă lâĆuvre du troisiĂšme jour de la crĂ©ation, câest-Ă -dire Ă la minĂ©ralogie, aux corpora mineralia20, Vincent de Beauvais Ă©largit la matiĂšre du livre V de la bifaria, quâil dĂ©veloppe par ailleurs en quatre livres distincts dans la trifaria. On lit dans la citation de lâActor au dĂ©but du chapitre 1 du livre VII :
« AprĂšs avoir parlĂ© de la nature de la terre, de sa fertilitĂ© et de sa culture, ainsi que des phĂ©nomĂšnes qui lâaffectent et des vapeurs, il reste Ă parler des corps terrestres qui apparaissent en partie dans les entrailles de la terre, en partie Ă sa surface, câest-Ă -dire les minĂ©raux, les couleurs naturelles et les pierres. Nous les avons en effet retranchĂ©s du livre prĂ©cĂ©dent, pour Ă©viter une dĂ©sagrĂ©able prolixitĂ©, et les avons rĂ©servĂ©es pour les (prĂ©senter) de maniĂšre plus dĂ©taillĂ©e dans les (livres) suivants. Ainsi, nous allons maintenant commencer par les corps minĂ©raux. »21
Dans le Speculum doctrinale, Vincent de Beauvais sâintĂ©resse spĂ©cifiquement Ă lâalchimie au livre XI, consacrĂ© aux arts mĂ©caniques22, aux chapitres 105 Ă 133. On trouve en outre quelques passages dissĂ©minĂ©s dans les autres livres : Ă la fin des livres V et VI du Speculum naturale, dans les descriptions du sel, de lâalun, du verre, et des corps terrestres, et au livre XV du Speculum doctrinale, dont les chapitres 57 Ă 65 portent sur les mineralia23.
Le livre VII du Speculum naturale sâarticule de la sorte. Vincent de Beauvais commence par prĂ©senter des principes thĂ©oriques sur les mĂ©taux et leur origine (thĂ©orie du soufre et du mercure) ; puis il discute rapidement les applications concrĂštes des opĂ©rations alchimiques ; il donne ensuite une longue description des diffĂ©rentes matiĂšres (surtout les mĂ©taux, ainsi que les esprits et dâautres substances) selon un schĂ©ma rĂ©gulier (dĂ©finition et nature ; travail en alchimie ; usages mĂ©dicaux). Lâordre des mĂ©taux citĂ©s est le suivant : or, argent, cuivre, (laiton), Ă©tain, plomb et fer, parmi lesquels sont insĂ©rĂ©es des descriptions de divers produits dĂ©rivĂ©s de ces mĂ©taux (sels, etc.). Du chapitre 81 au chapitre 97, il se penche sur des sujets plus directement alchimiques : lâĂ©lixir, la transmutation, les instruments des alchimistes, et diffĂ©rentes opĂ©rations. Aux chapitres 84 Ă 86, il fait Ă©cho au riche dĂ©bat du XIIIe siĂšcle sur la possibilitĂ© de la transmutation24. Les chapitres 98 Ă 104 reprennent des descriptions de diverses substances.
La structure des chapitres 105 Ă 133 du livre XI du Speculum doctrinale est assez proche de celle du livre VII du Speculum naturale, Ă lâexception de quelques points : tout dâabord, le nombre de citations est bien moindre dans le Speculum doctrinale, et Vincent de Beauvais commence par la question de la possibilitĂ© de la transmutation. Les opĂ©rations sur les substances sont insĂ©rĂ©es dans les chapitres contenant les descriptions des substances. Lâordre des mĂ©taux citĂ©s est lĂ©gĂšrement diffĂ©rent : or, argent, cuivre, fer, Ă©tain et plomb. Le Speculum doctrinale propose un condensĂ© synthĂ©tique du contenu du livre VII du Speculum naturale, plus directement axĂ© sur lâalchimie, mais dont de nombreuses citations sur la mĂ©tallurgie sont absentes.
DĂ©limitation du corpus de citations25
Une des difficultĂ©s de ce travail a consistĂ© Ă dĂ©limiter le corpus de citations. Se limiter aux citations purement alchimiques, câest-Ă -dire aux citations ne traitant que stricto sensu de la transmutation ou de la teinture des mĂ©taux, nâĂ©tait pas envisageable, car trop restreint pour apporter des rĂ©sultats significatifs. Jâai donc Ă©largi la collecte Ă la mĂ©tallurgie, ou encore Ă la minĂ©ralogie, Ă lâexclusion des pierres (qui font lâobjet du livre VIII et prĂ©sentent des sources diffĂ©rentes)26 et les processus plus gĂ©nĂ©raux (qui sont repris dans de trop nombreux endroits du Speculum maius). Le noyau a donc dâabord Ă©tĂ© collectĂ© Ă partir du livre VII du Speculum naturale et des chapitres 105 Ă 133 du livre XI du Speculum doctrinale, puis Ă©tendu Ă quelques passages de la fin des livres V et VI du Speculum naturale et Ă quelques extraits du livre XV du Speculum doctrinale. Certaines citations ont Ă©tĂ© exclues : les sources qui nâont pas de lien Ă©vident avec lâalchimie, qui ne sont pas des textes alchimiques ou qui ne sont pas liĂ©es assez directement Ă lâalchimie et la minĂ©ralogie. Ainsi, je nâanalyse pas les citations de Pline et dâIsidore, ni les autoritĂ©s mĂ©dicales comme Hali (âAlÄ« ibn al-âAbbÄs al-MajĆ«sÄ«), mĂȘme lorsquâelles portent sur les qualitĂ©s thĂ©rapeutiques des substances Ă©galement utilisĂ©es dans lâalchimie (mercure, etc.). Toutefois, jâai pris en considĂ©ration les citations du Liber de natura rerum, du Philosophus, des Meteora, ainsi que du De vaporibus attribuĂ© Ă AverroĂšs, car elles sont aussi employĂ©es comme des textes alchimiques dans le Speculum naturale, câest-Ă -dire dans des chapitres spĂ©cialement consacrĂ©s Ă lâalchimie par Vincent de Beauvais.
Ainsi, deux groupes de citations se dĂ©gagent : les traitĂ©s spĂ©cifiquement alchimiques, dont je collecte les citations de maniĂšre exhaustive dans le Speculum maius, que Vincent de Beauvais utilise pour dĂ©crire lâalchimie, et des traitĂ©s plus gĂ©nĂ©raux, dont je collecte les citations de maniĂšre exhaustive dans le Speculum maius, auxquels Vincent de Beauvais a recours dans diffĂ©rents domaines.
De la sorte, jâai dĂ©limitĂ© un corpus de 178 citations27, 110 dans le Speculum naturale et 68 dans le Speculum doctrinale, divisĂ©es selon dix « marqueurs »28. Vincent de Beauvais cite ainsi : le De anima alchimique du pseudo-Avicenne, un Alchimista et une Doctrina alchimiae (non identifiĂ©s), le De aluminibus et salibus, lâEpistola ad Hasen regem de re tecta attribuĂ©e Ă Avicenne, les Meteora (câest-Ă -dire les MĂ©tĂ©orologiques dâAristote, livre III et IV, et le De mineralibus dâAvicenne), un De vaporibus quâil attribue Ă AverroĂšs (en rĂ©alitĂ© les Quaestiones Nicolai Peripatetici), un Liber de natura rerum (Ă savoir le Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© et le Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham), un Philosophus (non identifiĂ©, qui cite le Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© et le Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham), et lâActor (vraisemblablement Vincent de Beauvais lui-mĂȘme).
Dans le tableau et le graphique qui suivent sont notĂ©es les statistiques quantitatives des 178 citations analysĂ©es pour cet article. La premiĂšre colonne contient le marqueur trouvĂ© dans le Speculum naturale et le Speculum doctrinale29. Les lignes qui ne sont pas en gras sont une dĂ©composition de la ligne prĂ©cĂ©dente : par exemple, la ligne du marqueur Meteora en gras est suivie de trois lignes qui ne sont pas en gras qui notent les trois parties des Meteora qui sont citĂ©es dans notre contexte (le livre III et le livre IV des MĂ©tĂ©orologiques dâAristote, et le De mineralibus dâAvicenne). La seconde colonne dĂ©crit le type de collecte que jâai faite : exhaustive (en bleu dans le graphique) ou non (en mauve). Les colonnes « mots SN » et « mots SD » indiquent respectivement le nombre de mots des citations dans le Speculum naturale et le Speculum doctrinale ; dans le mĂȘme ordre dâidĂ©es, les colonnes « cit. SN » et « cit. SD » notent le nombre de citations. Les pourcentages donnĂ©s (de mots et de citations) sont calculĂ©s par rapport Ă lâensemble du corpus de citations utilisĂ© dans cette Ă©tude. La collecte est quantitative uniquement, elle suit le nombre de mots et le nombre de citations. Le graphique est Ă©tabli selon le pourcentage du nombre de mots des extraits sous chaque marqueur par rapport au corpus total de citations. Les abrĂ©viations sont explicitĂ©es au dĂ©but de lâannexe I.
|
Marqueur |
type |
identifié |
mots SN |
mots SD |
total mots |
% nb. mots |
cit. SN |
cit. SD |
total cit. |
%Â nb. cit. |
|
Alchimista / Doctrina alchimiae |
exh. |
non |
3155 |
3007 |
6142 |
26,41Â % |
19 |
18 |
37 |
20,79Â % |
|
Alchimista |
exh. |
non |
1879 |
2347 |
4226 |
18,17Â % |
12 |
14 |
26 |
14,61Â % |
|
Doctrina alchimiae |
exh. |
non |
1256 |
660 |
1916 |
8,24Â % |
7 |
4 |
11 |
6,18Â % |
|
De anima |
exh. |
oui |
2158 |
2108 |
4266 |
18,35Â % |
16 |
14 |
30 |
16,85Â % |
|
De aluminibus et salibus |
exh. |
oui |
1682 |
1594 |
3276 |
14,09Â % |
18 |
14 |
32 |
17,98Â % |
|
Epistola ad Hasen regem |
exh. |
oui |
456 |
406 |
862 |
3,71Â % |
4 |
3 |
7 |
3,93Â % |
|
Meteora* |
non exh. |
oui |
1807 |
1407 |
3214 |
13,82Â % |
19 |
5 |
24 |
13,48Â % |
*Les nombres mentionnĂ©s de citations (et non de mots) en Meteora (total) sont infĂ©rieurs Ă la somme des nombres des citations de ses trois parties en raison des citations composites, câest-Ă -dire des citations qui contiennent Ă la fois des passages du livre IV des MĂ©tĂ©orologiques dâAristote et du De mineralibus dâAvicenne.
|
De mineralibus |
non exh. |
oui |
1556 |
1407 |
2963 |
12,74Â % |
14 |
5 |
19 |
10,67Â % |
|
Livre IV des MĂ©t. |
non exh. |
oui |
199 |
0 |
199 |
0,86Â % |
5 |
0 |
5 |
2,81Â % |
|
Livre III des MĂ©t. |
non exh. |
oui |
52 |
0 |
52 |
0,22Â % |
2 |
0 |
2 |
1,12Â % |
|
Liber de natura/is rerum** |
non exh. |
oui |
1793 |
464 |
2257 |
9,71Â % |
15 |
6 |
21 |
11,80Â % |
**Les nombres mentionnĂ©s de citations (et non de mots) en Liber de natura/is rerum sont infĂ©rieurs Ă la somme des nombres des citations de ses deux sources en raison dâune citation composite, câest-Ă -dire dâune citation qui contient Ă la fois des passages du Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© et du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham.
|
Liber de natura rerum de Thomas de Cantimpré |
non exh. |
oui |
442 |
436 |
878 |
3,78Â % |
6 |
5 |
11 |
6,18Â % |
|
Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham |
non exh. |
oui |
1351 |
28 |
1379 |
5,93Â % |
10 |
1 |
11 |
6,18Â % |
|
De vaporibus (QNP) |
non exh. |
oui |
2175 |
0 |
2175 |
9,35Â % |
10 |
0 |
10 |
5,62Â % |
|
Actor |
non exh. |
oui |
273 |
329 |
602 |
2,59Â % |
5 |
7 |
12 |
6,74Â % |
|
Philosophus*** |
non exh. |
non |
399 |
183 |
582 |
2,50Â % |
5 |
2 |
7 |
3,93Â % |
***Les nombres mentionnĂ©s de citations et de mots en Philosophus sont infĂ©rieurs Ă la somme des nombres des citations de ses deux sources identifiĂ©es en raison dâune citation non identifiĂ©e.
|
Liber de natura rerum de Thomas de Cantimpré |
non exh. |
oui |
120 |
183 |
303 |
1,30Â % |
2 |
2 |
4 |
2,25Â % |
|
Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham |
non exh. |
oui |
256 |
0 |
256 |
1,10Â % |
2 |
0 |
2 |
1,12Â % |
|
Total |
 |
 |
13830 |
9442 |
23252 |
100Â % |
110 |
68 |
178 |
100Â % |
Â

Â
Dans la suite de lâarticle, les sources sont ordonnĂ©es selon le type de collecte, puis selon leur longueur, de lâautoritĂ© la plus citĂ©e Ă la moins citĂ©e (Ă lâexception de lâActor, placĂ© en fin dâarticle). LâAlchimista et la Doctrina alchimiae sont regroupĂ©es, en raison de certaines convergences expliquĂ©es plus loin.
MĂ©thode dâidentification des sources
Lâidentification sâest dĂ©roulĂ©e en deux temps. Une premiĂšre phase, que lâon pourrait qualifier de traditionnelle, a consistĂ© Ă identifier Ă partir du marqueur les traitĂ©s susceptibles dâĂȘtre des sources, Ă lire les ouvrages en question et Ă reconnaĂźtre les passages citĂ©s. Cette mĂ©thode, chronophage, prĂ©sente des inconvĂ©nients : des passages Ă©chappent Ă lâattention du chercheur. En outre, les textes dont le marqueur est Ă©loignĂ© du titre authentique, ou dont le titre varie de façon importante, comme câest frĂ©quemment le cas pour les traitĂ©s mĂ©diĂ©vaux alchimiques, restent souvent impossibles Ă identifier. Lâexemple du De vaporibus attribuĂ© Ă AverroĂšs le montre : ce texte, mieux connu sous le titre Quaestiones Nicolai Peripatetici, varie dans son titre et son attribution selon les manuscrits. Sans la vigilance de StanisĆaw Wielgus, lâĂ©diteur des Quaestiones Nicolai Peripatetici, et le concours de la chance, les extraits du De vaporibus resteraient probablement non identifiĂ©s.
Les outils informatiques modernes peuvent ici apporter une certaine aide Ă lâidentification textuelle de citations. Jâai ainsi utilisĂ© le programme informatique Ă©laborĂ© par Ilse De Vos et Jan Keymeulen30 dans le cadre dâune thĂšse de doctorat : faisant appel Ă un algorithme Ă©tabli pour les identifications automatiques de plagiat dans les travaux universitaires selon la distance Levenshtein-Damerau, ils ont dĂ©veloppĂ© un programme permettant dâidentifier des proximitĂ©s textuelles entre deux Ă©crits. Une fois choisi le texte ou le corpus de textes Ă identifier, on propose un texte ou un corpus de textes que lâon sait ou que lâon soupçonne ĂȘtre une source, on configure le programme selon le degrĂ© de transformation supposĂ© (distance Levenshtein-Damerau), et le logiciel trouve automatiquement les parallĂšles. Cette mĂ©thode est intĂ©ressante en particulier pour lâidentification des sources internes : elle mâa permis de dĂ©couvrir que le Liber de natura/is rerum que cite Vincent de Beauvais contenait des citations internes du De aluminibus et salibus. Cependant, elle comporte Ă©galement un inconvĂ©nient majeur : il faut lui proposer un corpus de textes susceptibles dâĂȘtre des sources, et ce corpus doit ĂȘtre prĂ©alablement saisi31.
Â
Les sources alchimiques de Vincent de Beauvais
Â
Les collectes exhaustives : les traités alchimiques
LâAlchimista et la Doctrina alchimiae
Le traité
Lâexamen de lâAlchimista (= Alc) et la Doctrina alchimiae (= Dalc) sont conjoints, car on trouve cinq citations et/ou segments de citations qui sont attribuĂ©s Ă la Doctrina alchimiae dans le Speculum naturale et Ă lâAlchimista dans le Speculum doctrinale32. En outre, on trouve une phrase dâun extrait attribuĂ© Ă la Doctrina alchimiae uniquement prĂ©sent dans le Speculum naturale (SN, 7, 88a1) qui se retrouve dans un extrait attribuĂ© Ă lâAlchimista dans le Speculum naturale et le Speculum doctrinale (SN, 7, 91c â SD, 11, 128c)33. Ce faisceau dâindices indique quâil sâagit selon toute vraisemblance dâun seul et mĂȘme texte que Vincent de Beauvais nomme de deux maniĂšres distinctes, dont le titre serait Doctrina alchimiae et qui serait anonyme, dâoĂč lâutilisation du terme Alchimista par le dominicain. Il faut ajouter que lâemploi de lâexpression Alchimista pourrait dĂ©signer un contemporain, que Vincent de Beauvais ne cite jamais nommĂ©ment. Ce texte nâest pas identifiĂ©.
LâAlchimista/ Doctrina alchimiae est un ouvrage plus tardif que dâautres textes citĂ©s par Vincent de Beauvais, car jâai pu identifier diffĂ©rentes sources internes (cf. annexe pour la comparaison textuelle). Les citations marquĂ©es Alchimista comprennent les citations internes suivantes :
-
deux citations du Canon dâAvicenne traduit en latin par GĂ©rard de CrĂ©mone34 : une citation non marquĂ©e, littĂ©rale35 : SN, 6, 79b â SD, 11, 121b2 ; et une citation marquĂ©e, ou plutĂŽt une allusion au Canon, lib. 1, fen 1, doc. 3, c. II (De complexionibus membrorum)36 : SN, 7, 95a â SD, 11, 132a ;
-
deux citations marquĂ©es37 de lâEpistola ad Hasen regem de re tecta (= EAHR) attribuĂ©e Ă Avicenne (cf. ci-dessous p. 20), traduction latine non datĂ©e, qui sont assez littĂ©rales : SN, 7, 91c â SD, 11, 128c ; et SN, 7, 91a â SD, 11, 128a ;
-
deux citations non marquĂ©es de la version P du De aluminibus et salibus (= DAESP) (cf. ci-dessous p. 17), traduction non datĂ©e, qui sont Ă©galement assez littĂ©rales : SN, 7, 91c â SD, 11, 128c ; et SN, 7, 91a â SD, 11, 128a ;
-
une citation marquĂ©e38 du livre XXXIV (Liber reprehensionis) du Liber de LXX de Geber (nom latinisĂ© de lâalchimiste lĂ©gendaire JÄbir ibn កayyÄn39), peut-ĂȘtre traduit par GĂ©rard de CrĂ©mone40, citation assez Ă©loignĂ©e de lâoriginal : SN, 7, 96a1 â SD, 11, 133a1 ;
-
une citation marquĂ©e41 du Liber graduum de Constantin lâAfricain (â  avant 1098/ 1099), citation assez Ă©loignĂ©e de lâoriginal : SN, 7, 96a3 â SD, 11, 133a3.
-
une citation marquĂ©e Ioannes Damascenus, qui est en rĂ©alitĂ© une rĂ©fĂ©rence Ă la traduction latine des Aphorismi de Jean MĂ©suĂ© (Ibn MÄsawayh), rĂ©alisĂ©e Ă la fin du XIIe siĂšcle (qui a circulĂ© sous le nom de Jean DamascĂšne)42.
Les citations marquĂ©es Doctrina alchimiae, quant Ă elles, se limitent Ă une citation interne non marquĂ©e de lâEpistola ad Hasen regem, qui est assez Ă©loignĂ©e de lâoriginal : SN, 7, 88a1.
Le texte, un recueil selon toute vraisemblance, est forcĂ©ment postĂ©rieur Ă ces sources, mais la plupart de ces traductions Ă©tant non datĂ©es, on doit se contenter de conjecturer une datation vers lâextrĂȘme fin du XIIe siĂšcle ou dans la premiĂšre moitiĂ© du XIIIe siĂšcle.
En SN, 7, 82a â SD, 11, 125a, lâAlchimista fait allusion Ă la possibilitĂ© dâutiliser les Ćufs, les cheveux et le sang pour la confection de lâĂ©lixir ; cet Ă©lĂ©ment de doctrine tire probablement son origine du De anima pseudo-avicennien ou de lâEpistola ad Hasen regem attribuĂ©e Ă Avicenne (cf. ci-dessous p. 20), dont lâinfluence dans le domaine du choix de la pierre (substance Ă partir de laquelle on fait lâĂ©lixir) est dominante jusquâĂ la fin du XIIIe siĂšcle (et lâarrivĂ©e de la Summa perfectionis du pseudo-Geber) : ces trois substances organiques sont en effet la base de leur Ă©lixir.
On observe en SN, 7, 88a2 â SD, 11, 107b une citation de la Doctrina alchimiae contenant deux italianismes (melangoli et arangii, qui dĂ©signent tous deux lâorange) ainsi quâune rĂ©fĂ©rence Ă lâarchevĂȘchĂ© de GĂȘnes, mais le caractĂšre composite du texte ne permet pas de former une conjecture prĂ©cise Ă partir de ces Ă©lĂ©ments ; il pourrait sâagir dâun texte citĂ© dans la Doctrina alchimiae.
Lâutilisation par Vincent de Beauvais
LâAlchimista et la Doctrina alchimiae nâapparaissent pas dans les livres de la version bifaria qui sont conservĂ©s.
LâAlchimista est citĂ© 26 fois (12 dans le SN, 14 dans le SD). La Doctrina alchimiae est citĂ©e 11 fois (7 dans le SN, 4 dans le SD), sous les marqueurs suivants : Alchimista (ou Alchymista), Ex verbis alchimiste ; Ex doctrina alchimie (ou alchymie). Les citations de lâAlchimista et de la Doctrina alchimiae se trouvent dans les livres 5, 6 et 7 pour le Speculum naturale (une citation pour le livre V et une pour le livre VI), et toujours dans le livre XI du Speculum doctrinale. La plupart des citations se retrouvent Ă la fois dans le Speculum naturale et le Speculum doctrinale, Ă lâexception de SD, 11, 121b, qui nâest repris que partiellement dans SN, 6, 79b et SN, 7, 88a, partiellement dans SD, 11, 107b.
Comme il a Ă©tĂ© dit, lâattribution est parfois diffĂ©rente entre le Speculum naturale et le Speculum doctrinale. Les chapitres dans lesquels on trouve ces citations sont surtout les chapitres purement alchimiques, tels que ceux sur lâĂ©lixir ou la transmutation, ainsi que sur diverses opĂ©rations. Elles sont cependant aussi utilisĂ©es, mais trĂšs rarement, pour les descriptions de substances, notamment celles de lâalun et du laiton. La Doctrina alchimiae est la seule source citĂ©e pour dĂ©crire les instruments des alchimistes (SN, 7, 88a2 â SD, 11, 107b).
Dans la citation SN, 7, 91a â SD, 11, 128a, on trouve une citation interne de lâEpistola ad Hasen regem (attribuĂ©e Ă Avicenna), ce qui a causĂ© une erreur de marqueur dans le Speculum doctrinale : lâextrait y est prĂ©sentĂ© comme une citation dâAvicenne, mais le Speculum naturale nous permet de voir quâil sâagit bien dâune citation de lâAlchimista qui contient une citation interne de lâEpistola ad Hasen regem. En outre, le marqueur est « Dicit autem princeps aboali, scilicet Avicenna » : les marqueurs de Vincent de Beauvais ne sont pas structurĂ©s de la sorte, et ce marqueur nâest jamais utilisĂ© pour lâEpistola ad Hasen regem. De plus, aucun passage de lâEpistola ad Hasen regem ne correspond Ă lâintĂ©gralitĂ© de la citation du Speculum naturale, et cette derniĂšre contient aussi une citation de la version P De aluminibus et salibus non marquĂ©e par lâAlchimista. Cf. également ci-dessous p. 20.
Le passage SN, 7, 70c â SD, 11, 130b1, quant Ă lui, est une citation de lâEpistola ad Hasen regem qui est attribuĂ©e Ă lâEpistola ad Hasen regem dans le Speculum doctrinale, mais Ă la Doctrina alchimiae dans le Speculum naturale. Cf. à ce sujet ci-dessous p. 20.
Il faut enfin mentionner la citation SN, 7, 67b, qui est une glose de Vincent de Beauvais (Actor) dans laquelle le passage SN, 7, 60b1 â SD, 11, 105d1 est partiellement repris (attribuĂ© Ă la Doctrina alchimiae dans le SN et Ă lâAlchimista dans le SD).
Le Liber de anima alchimique attribué à Avicenne
Le traité
Le De anima alchimique du pseudo-Avicenne, plus connu sous le nom de De anima in arte alchemiae (= DA), est la compilation et la traduction latine de trois traitĂ©s arabes perdus Ă ce jour43. La traduction semble dater de 1226/ 123544, mais lâĂ©tape de compilation est impossible Ă dater. Par ailleurs, il est impossible dâaffirmer si le traitĂ© a dâabord Ă©tĂ© compilĂ© puis traduit, ou inversement : la date de traduction pourrait donc ne porter que sur une des trois parties de lâouvrage. La premiĂšre partie du De anima est un traitĂ© de physique Ă©lĂ©mentaire, la Porta elementorum ; lâoriginal arabe (perdu Ă ce jour) a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© avant le milieu du XIIe siĂšcle, et a probablement Ă©tĂ© traduit en Espagne ou par un traducteur connaissant le castillan, en raison de la transformation linguistique de certains mots45. Il existe une autre traduction latine du traitĂ© arabe dans le manuscrit Cotton Galba E IV, sous le titre De elementis, attribuĂ©e Ă un certain Marius46. La deuxiĂšme partie du De anima, de loin la plus longue et la plus dĂ©taillĂ©e (environ 80 %), dĂ©crit lâalchimie du De anima : elle contient non seulement les principes thĂ©oriques de lâalchimie du De anima, mais aussi de nombreuses recettes. Elle a Ă©tĂ© composĂ©e entre le troisiĂšme quart du XIe siĂšcle et le milieu du XIIIe siĂšcle, en Andalus (Espagne islamique)47 ; elle a Ă©tĂ© traduite en Espagne ou par un traducteur connaissant le castillan, comme le montrent de nombreux mots castillans dans lâouvrage. La troisiĂšme partie du De anima a vraisemblablement Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e pour complĂ©ter la deuxiĂšme partie, dont la fin Ă©tait manquante. On en ignore la date et le lieu de composition ; on peut Ă©mettre lâhypothĂšse dâune traduction en Espagne ou par un traducteur connaissant le castillan, en raison de traces linguistiques48. Le traitĂ© est faussement attribuĂ© Ă Avicenne49. Lâalchimie du De anima est une alchimie de type jÄbirien50, basĂ©e spĂ©cifiquement sur les substances organiques : il propose de fabriquer les Ă©lixirs Ă partir de substances organiques, le sang, les cheveux et les Ćufs. Le traitĂ© est conservĂ© dans huit manuscrits51. Le De anima a Ă©tĂ© publiĂ© par Mino Celsi en 1572 Ă BĂąle, chez Pietro Perna, dans un recueil intitulĂ© Artis chemicae principes, Avicenna atque Geber52.
Lâutilisation par Vincent de Beauvais
Le De anima nâapparaĂźt pas dans les livres de la version bifaria qui sont conservĂ©s.
Le texte du De anima citĂ© par Vincent de Beauvais sâapparente Ă la famille de manuscrits L C F V53 ; la version prĂ©sente dans le Speculum doctrinale est beaucoup plus proche de mon Ă©dition du De anima que celle du Speculum naturale, probablement en raison dâune corruption du texte du Speculum naturale. Il est citĂ©Â 30 fois (16 dans le SN, 14 dans le SD), sous les marqueurs suivants : Avicenna in libro de anima, Avicenna in libro alchimie qui dicitur de anima, Avicenna in alchymia de anima, Avicenna in libro alchymie de anima, Avicenna in libro alchymie. Le De anima est toujours citĂ© dans le livre VII du Speculum naturale et dans le livre XI du Speculum doctrinale, et tous les extraits se retrouvent Ă la fois dans le Speculum naturale et le Speculum doctrinale. Lâattribution est toujours semblable entre le Speculum naturale et le Speculum doctrinale. Le De anima est principalement utilisĂ© par Vincent de Beauvais dans les descriptions des substances et des types dâopĂ©rations qui sây rapportent. Il est Ă©galement citĂ© dans les chapitres spĂ©cialement consacrĂ©s aux opĂ©rations sur les substances dans lâalchimie. Seule la deuxiĂšme partie du De anima est citĂ©e : plus prĂ©cisĂ©ment encore, tous les extraits proviennent des dictiones54 1, 4 et 5.
Vincent de Beauvais nâemploie que les parties thĂ©oriques du De anima, sans reprendre de recette, alors que le De anima est un traitĂ© plus pratique que thĂ©orique, qui contient avant tout des recettes et des conseils techniques. En outre, Vincent de Beauvais ne conserve que des extraits comprĂ©hensibles du De anima, dont de nombreux passages sont obscurs. Le dominicain va jusquâĂ supprimer des expressions qui posent problĂšme dans la phrase (par exemple en SN, 7, 61c â SD, 11, 119a1, oĂč est supprimĂ© le pro multo aere dont le sens est problĂ©matique Ă premiĂšre lecture). Les citations ne sont pas toujours littĂ©rales, mais restent plus fidĂšles au texte que celles du De aluminibus et salibus (cf. ci-dessous 17), en contractant les extraits : Vincent de Beauvais omet des passages qui peuvent Ă©loigner le lecteur du sujet quâil traite (par exemple SN, 7, 4a â SD, 11, 110a, ou bien SN, 7, 54b â SD, 11, 114b, ou encore SN, 7, 82b â SD, 11, 125b55). Contrairement aux citations du De aluminibus et salibus, celles du De anima conservent plusieurs transcriptions de mots arabes (par exemple en SN, 7, 13c â SD, 11, 111b, le mot orizum correspondant au ebrizum du De anima qui transcrit lâarabe ibrÄ«z, « or pur »). Parfois cependant, le rĂ©sumĂ© dâun long passage provoque la perte des arguments du texte, peut-ĂȘtre Ă cause dâune mĂ©comprĂ©hension (comme dans le cas de SN, 7, 85b â SD, 11, 106b1).
Une citation particuliĂšre mĂ©rite quâon sây attarde. En SN, 7, 87a â SD, 11, 107a, on observe une liste de noms dâalchimistes qui font autoritĂ© dans le domaine, dont Vincent de Beauvais ne retient quâune partie. Le De anima propose en effet une longue liste dâautoritĂ©s alchimiques, dont de nombreux noms ont Ă©tĂ© transcrits de lâarabe sans quâon puisse en deviner lâorigine, en raison de leur trop grande dĂ©formation ; Ă cette liste dâautoritĂ©s mythiques, bibliques et arabes a Ă©tĂ© ajoutĂ©e une sĂ©rie de noms chrĂ©tiens, probablement par le traducteur (et/ou compilateur ?) du De anima56. Vincent de Beauvais limite sa citation aux autoritĂ©s bibliques et Ă quelques auteurs arabes (uniquement les plus connus, comme Geber), et insiste surtout sur les autoritĂ©s chrĂ©tiennes. Lâordre de la liste reste relativement le mĂȘme, Ă lâexception de Virgilius57, que le dominicain place beaucoup plus haut dans la liste, pour induire une plus grande cohĂ©rence typologique des autoritĂ©s.
La citation SN, 7, 4a â SD, 11, 110a contient une divergence thĂ©orique importante entre le Speculum naturale et le Speculum doctrinale (le nombre des mĂ©taux), qui sâexplique par une corruption de la tradition manuscrite (cf. annexe).
Le De aluminibus et salibus
Le traité
Le De aluminibus et salibus (= DAES) est un traitĂ© anonyme arabe dâalchimie pratique qui a Ă©tĂ© traduit en hĂ©breu et en latin58. Lâouvrage est le plus souvent anonyme, parfois attribuĂ© Ă HermĂšs, plus rarement Ă RÄzÄ« (dans le seul manuscrit Paris, BnF, Lat. 6514, f. 125r-v, et chez Vincent de Beauvais), probablement en raison du cĂŽtĂ© pratique de lâalchimie quâil dĂ©crit. Son titre varie dans les manuscrits : on trouve notamment le titre De spiritibus et corporibus59, et câest selon ce titre que Roger Bacon cite lâouvrage. Il semble avoir Ă©tĂ© rĂ©digĂ© en Espagne au XIe ou au XIIe siĂšcle. La version arabe nâest conservĂ©e que partiellement dans le seul manuscrit Berlin, Staatsbibliothek, Sprenger 190860, elle a Ă©tĂ© Ă©ditĂ©e par Julius Ruska en 193561. Le texte latin existe selon dans trois versions diffĂ©rentes :
-
une premiÚre version, appelée version P (= DAESP), éditée par Robert Steele (selon peu de manuscrits)62, qui est celle utilisée par Vincent de Beauvais ;
-
une seconde version, nommĂ©e version G (= DAESG)63, en raison de son Ă©dition parmi les Ćuvres de Jean de Garlande en 156064, Ă©ditĂ©e par Ruska aux cĂŽtĂ©s de la version arabe65, qui est celle utilisĂ©e par Roger Bacon ; Catherine Arbuthnott a identifiĂ© une autre copie de cette version dans le manuscrit Oxford, Bodleian Library, Digby 119, ff. 167v-175r, quâelle appelle « Digby version »66 ;
-
une troisiĂšme version, qui se prĂ©sente plus comme une adaptation quâune traduction et qui ressemble Ă la version P, dont on trouve des fragments dans le Liber claritatis Ă©ditĂ© par Darmstaedter67, appelĂ©e version L.cl.68.
Lâouvrage est rĂ©pertoriĂ© comme une traduction de GĂ©rard de CrĂ©mone dans la liste dressĂ©e par ses socii69. Toutefois, en lâabsence dâĂ©tudes approfondies, il est difficile de dĂ©terminer, parmi les trois versions ci-dessus, quelle est la sienne. Une nouvelle Ă©dition de la version arabe et des fragments hĂ©breux est actuellement prĂ©parĂ©e par Gabriele Ferrario, et Catherine Arbuthnott70 travaille en ce moment Ă lâĂ©dition critique de la version latine. Les Ă©ditions critiques et lâĂ©tude de la tradition manuscrite sont tout particuliĂšrement souhaitĂ©es, car elles permettront de se pencher sur le texte avec plus de prĂ©cision.
Lâutilisation par Vincent de Beauvais
Le De aluminibus et salibus est utilisĂ© dans les livres de la version bifaria qui nous sont conservĂ©s ; il nây est cependant citĂ© quâune seule fois, au sujet de lâĂ©tain, sous le marqueur Ex libro de aluminibus et salibus. La citation (Bif., 5, 91c), une seule phrase trĂšs brĂšve, correspond au dĂ©but de la citation SN, 7, 38a â SD, 11, 115a et se termine dans les deux manuscrits par lâabrĂ©viation de lâexpression et cetera71. Cela permet dâĂ©mettre deux hypothĂšses : soit Vincent de Beauvais lâa ajoutĂ© en toute fin de composition de la version bifaria, sans avoir le temps de lâutiliser davantage, soit il nâavait accĂšs quâĂ une version partielle et il sâest procurĂ© le texte complet pour la version trifaria.
Le De aluminibus et salibus est citĂ© 32 fois72 (18 dans le SN, 14 dans le SD), sous les marqueurs suivants : Ex libro de aluminibus et salibus, Razi in libro de aluminibus et salibus, Razi in libro de aluminibus, Ex libro Razi de aluminibus et salibus. Vincent de Beauvais attribue lâouvrage Ă RÄzÄ«. Il le cite dans les livres V (2 fois), VI (1 fois) et VII du Speculum naturale, et toujours dans le livre XI du Speculum doctrinale. Tous les extraits se retrouvent Ă la fois dans le Speculum naturale et le Speculum doctrinale, toujours avec la mĂȘme attribution. Vincent de Beauvais utilise principalement le De aluminibus et salibus dans les descriptions des substances et les types dâopĂ©rations qui sây rapportent, particuliĂšrement dans les chapitres spĂ©cialement consacrĂ©s aux opĂ©rations sur les substances dans lâalchimie, Ă lâinstar du De anima. Il nâa recours quâaux parties thĂ©oriques du traitĂ©, alors que le De aluminibus et salibus est un traitĂ© trĂšs technique proposant de nombreuses informations pratiques.
Les citations du De aluminibus et salibus ne sont pas toujours littĂ©rales. Parfois Vincent de Beauvais ne cite que certaines parties de la description dâun produit (par exemple en SN, 5, 86a â SD, 11, 118a1, ou bien en SN, 7, 18b â SD, 11, 112a). TantĂŽt, il supprime des phrases chargĂ©es de sens mais sans rapport direct avec lâalchimie (par exemple en SN, 7, 6b â SD, 11, 105c)73. Contrairement aux citations du De anima, celles du De aluminibus et salibus ne comptent que peu de transcriptions de termes arabes, qui sont gĂ©nĂ©ralement Ă©cartĂ©es du texte (par exemple en SN, 5, 86a â SD, 11, 118a1, ou bien en SN, 7, 42c â SD, 11, 116a, ou encore en SN, 7, 75a â SD, 11, 122a1). Vincent de Beauvais supprime plusieurs passages Ă la premiĂšre personne (par exemple en SN, 7, 67a â SD, 11, 118a3). Mais il est Ă©galement possible quâil ait utilisĂ© une version abrĂ©gĂ©e qui ne nous est pas parvenue, ou qui nâest pas Ă©ditĂ©e. Ces omissions conduisent parfois Ă des contresens importants (par exemple en SN, 7, 6b â SD, 11, 105c).
La citation SN, 7, 42c â SD, 11, 116a contient une transformation du texte : on lit dans le Speculum naturale « Convenerunt greci philosophi », et dans le Speculum doctrinale « Convenerunt inde philosophi », alors que le De aluminibus et salibus contient « Et convenerunt philosophi Indi ». Il sâagit en rĂ©alitĂ© dâune altĂ©ration du texte dans la tradition manuscrite (ou directement dans lâĂ©dition de Douai74) du Speculum naturale, car le manuscrit du Speculum naturale Paris, BnF, Lat. 14387, et le manuscrit du Speculum doctrinale Paris, BnF, Lat. 16100, donnent « Convenerunt indi philosophi »75.
La citation SD, 11, 122a est sans marqueur, mais correspond bien à un passage du De aluminibus et salibus (qui se retrouve en deux parties dans SN, 7, 75a et SN, 5, 94d).
Le De aluminibus et salibus comme source interne
Jâai pu identifier diffĂ©rents emplois du De aluminibus et salibus comme source interne dans dâautres citations. LâAlchimista cite la version P du De aluminibus et salibus en SN, 7, 91a â SD, 11, 128a et en SN, 7, 91c â SD, 11, 128c (cf. ci-dessus p. 10). Le Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham et le Philosophus citent la version G du De aluminibus et salibus en plusieurs endroits (cf. ci-dessous p. 28 et 32).
Les citations internes dans le De aluminibus et salibus chez Vincent de Beauvais
Dans les citations du De aluminibus et salibus que fait Vincent de Beauvais, certaines contiennent elles-mĂȘmes des citations internes marquĂ©es, câest-Ă -dire des citations dâautres auteurs dĂ©jĂ prĂ©sentes dans le De aluminibus et salibus et, par consĂ©quent, reprises dans les extraits citĂ©s. Ainsi, on trouve une citation dâun certain Armenides (un pseudo-ParmĂ©nide alchimique ?) en SN, 7, 42c â SD, 11, 116a, et une citation de Geber en SN, 7, 75a â SD, 11, 122a1. Je nâai pas investiguĂ© davantage ces citations internes, qui sont celles du De aluminibus et salibus lui-mĂȘme. Il faut aussi souligner les citations SN, 7, 90a â SD, 11, 127a, dans lesquelles Vincent de Beauvais reprend une citation de Geber faite dans le De aluminibus et salibus sans mentionner le nom de Geber, alors quâil figure dans le De aluminibus et salibus.
LâEpistola ad Hasen regem de re tecta dâAvicenne
Le traité
LâEpistola ad Hasen regem de re tecta (= EAHR) est la traduction latine dâun traitĂ© alchimique arabe, la RisÄlat al-iksÄ«r (EpĂźtre sur lâĂ©lixir), attribuĂ© Ă Avicenne (980-1037)76. Plusieurs savants se sont penchĂ©s sur la question de lâauthenticitĂ© de ce traitĂ©, qui pourrait ĂȘtre une Ćuvre vĂ©ritable du philosophe persan. Ruska en avait rejetĂ© lâauthenticitĂ© pour trois raisons : Avicenne se prononce contre la transmutation des espĂšces, le dĂ©dicataire de lâĂ©pĂźtre, le cheik AbĆ« al-កasan Sahl ibn Muáž„ammad al-SahlÄ«, est inconnu, et plusieurs toponymes dans la version latine se rapportent Ă lâOccident arabe. Il supposait donc une rĂ©daction plus tardive, en Andalus. Ahmed Atech rĂ©fute les arguments de Ruska : lâĂ©pĂźtre porte sur la teinture des mĂ©taux, et non sur leur transmutation, le dĂ©dicataire inconnu pourrait bien ĂȘtre AbĆ« al-កusayn Aáž„mad ibn Muáž„ammad al-SahlÄ«, vizir de KhwÄrizmshÄh âAlÄ«, qui offrit sa protection Ă Avicenne lorsquâil vint au KhwÄrizm, et le texte arabe ne comporte aucun toponyme occidental, Ruska sâest laissĂ© abuser par la version latine. La question reste dĂ©battue cependant. Lâaffirmation dâAtech au sujet de la teinture est sujette Ă caution, car lâEpistola ad Hasen regem propose lâemploi dâĂ©lixirs, dont le principe dâaction porte sur les Ă©lĂ©ments et est censĂ© transmuter complĂštement le mĂ©tal. Stapleton, quant Ă lui, rĂ©sout le problĂšme en supposant quâAvicenne a changĂ© dâavis entre la rĂ©daction de la RisÄlat al-iksÄ«r et le KitÄb al-maâÄdin wa al-ÄthÄr al-âulwiyya. Lâalchimie prĂŽnĂ©e dans lâEpistola ad Hasen regem sâinspire notamment de celle de RÄzÄ« et, par voie de consĂ©quence, de celle des traitĂ©s jÄbiriens.
Lâutilisation par Vincent de Beauvais
LâEpistola ad Hasen regem nâapparaĂźt pas dans les livres de la version bifaria qui sont conservĂ©s.
Elle est citĂ©e 7 fois dans la trifaria (4 dans le SN, 3 dans le SD)77, sous les marqueurs suivants : Avicenna in epistola ad Basem, Avicenna in epistola ad Hasen, Ex epistola Avicenne ad Hasen. Les citations se trouvent toutes dans le livre VII du Speculum naturale et dans le livre XI du Speculum doctrinale. Toutes se retrouvent Ă la fois dans le Speculum naturale et dans le Speculum doctrinale. LâEpistola ad Hasen regem est utilisĂ©e par Vincent de Beauvais principalement dans la description des procĂ©dĂ©s alchimiques et des opĂ©rations sur les substances. Les passages citĂ©s ne sont jamais des recettes ni des descriptions trĂšs techniques, comme pour le De anima alchimique et le De aluminibus et salibus. Les citations, assez littĂ©rales, sont souvent rĂ©sumĂ©es, en gardant cependant des morceaux de phrases complets (par exemple en SN, 7, 93b â SD, 11, 130b). Comme dans le De aluminibus et salibus, Vincent de Beauvais supprime un certain nombre de passages Ă la premiĂšre personne78 (par exemple en SN, 7, 93b â SD, 11, 130b), tout en en conservant quelques-uns (par exemple en SN, 7, 70c â SD, 11, 130b1).
La citation SN, 7, 83a â SD, 11, 126a est particuliĂšrement intĂ©ressante, car elle est suivie dans les deux ouvrages dâun assez long commentaire intitulĂ© Glossa (SN, 7, 83b â SD, 11, 126b). Cette glose nâest pas le fait de Vincent de Beauvais, car elle contient des donnĂ©es alchimiques assez Ă©laborĂ©es et surtout une rĂ©fĂ©rence Ă Morien, prĂ©cisĂ©ment au Liber de compositione alchimiae, une traduction latine dâun traitĂ© alchimique arabe, la RisÄlat MaryÄnus al-RÄhib al-áž„akÄ«m li-al-amÄ«r KhÄlid ibn YazÄ«d (EpĂźtre du moine Morien le sage au prince KhÄlid ibn YazÄ«d), que Vincent de Beauvais ne cite jamais. Sâil avait eu un exemplaire du Morienus, il lâaurait certainement utilisĂ©, car ce traitĂ© est une autoritĂ© importante : il est par exemple mentionnĂ© dans le De anima alchimique, que Vincent de Beauvais possĂ©dait, mais il sâagit ici dâun autre passage (la citation ne peut donc pas avoir Ă©tĂ© tirĂ©e du De anima).
La citation SN, 7, 70c, qui correspond Ă la premiĂšre partie de la citation SD, 11, 130b et qui est manifestement tirĂ©e de lâEpistola ad Hasen regem, est marquĂ©e comme venant de lâEpistola ad Hasen regem dans le Speculum doctrinale et est attribuĂ©e Ă la Doctrina alchimiae dans le Speculum naturale ; cette attribution se retrouve dans le manuscrit du Speculum naturale Paris, BnF, Lat. 14387. LâhypothĂšse dâune confusion de marqueurs par Vincent de Beauvais est Ă retenir, car la citation SN, 7, 70c est reprise mot pour mot dans le Speculum doctrinale, et y est attribuĂ©e Ă lâEpistola ad Hasen regem ; il est trĂšs peu probable quâil sâagisse dâune citation interne, parce que lâunique citation interne de lâEpistola ad Hasen regem dans la Doctrina alchimiae en SN, 7, 88a1 est assez Ă©loignĂ©e de lâoriginal.
La citation SN, 7, 92a â SD, 11, 129a est trĂšs lĂ©gĂšrement tronquĂ©e dans le Speculum naturale, en raison dâune corruption de la tradition manuscrite : le manuscrit du Speculum naturale Paris, BnF, Lat. 14387 contient en effet la partie manquante dans lâĂ©dition de Douai.
LâEpistola ad Hasen regem comme source interne
LâEpistola ad Hasen regem est citĂ©e dans lâAlchimista en SN, 7, 91a â SD, 11, 128a et en SN, 7, 91c â SD, 11, 128c, ce qui a causĂ© une erreur de marqueur dans le SD (cf. ci-dessus p. 10).
LâEpistola ad Hasen regem est Ă©galement citĂ©e comme source interne dans la Doctrina alchimiae en SN, 7, 88a1 (cf. ci-dessus p. 10).
Â
Les collectes non exhaustives : les traitĂ©s sâattardant sur lâalchimie
Les MĂ©tĂ©orologiques dâAristote et le De mineralibus dâAvicenne
Les traités
Les MĂ©tĂ©orologiques dâAristote et le De mineralibus dâAvicenne79 sont ici groupĂ©s sous le mĂȘme intitulĂ©, car Vincent de Beauvais les traite sous le mĂȘme groupe de marqueurs. La version latine des MĂ©tĂ©orologiques dâAristote est le rĂ©sultat dâune traduction dont lâhistoire est assez complexe : les trois premiers livres ont Ă©tĂ© traduits de lâarabe (Ă partir dâun abrĂ©gĂ©) par GĂ©rard de CrĂ©mone80 (â  1187), et le quatriĂšme livre (= 4Met) a Ă©tĂ© traduit du grec par Henri Aristippe81 (â  1162). Cependant, dans les annĂ©es 116082, Alfred de Sareshill dĂ©cide de pallier un manque dans le quatriĂšme livre dâAristote, qui affirmait Ă la fin du livre III quâil allait sâattarder sur les mĂ©taux, qui ne sont cependant pas dĂ©crits dans le livre IV. Pour ce faire, il traduit et rĂ©sume une partie du cinquiĂšme fann des áčabÄ«âiyyÄt (physiques) du KitÄb al-ShifÄâ dâAvicenne (980-1037), intitulĂ© KitÄb al-maâÄdin wa al-ÄthÄr al-âulwiyya83 (Livre des minĂ©raux et des phĂ©nomĂšnes cĂ©lestes) : il postule en effet probablement quâAvicenne a utilisĂ© le texte perdu dâAristote pour composer son propre texte, et tente donc de reconstruire le discours dâAristote Ă partir de celui dâAvicenne84. Cette traduction, intitulĂ©e De mineralibus (= DM), et plus souvent connue sous le titre erronĂ© de De congelatione et conglutinatione lapidum85, fut adjointe par Alfred de Sareshill Ă la fin du livre IV des MĂ©tĂ©orologiques, et fut ensuite considĂ©rĂ©e par la plupart des auteurs comme une Ćuvre authentique dâAristote86. LâautoritĂ© dâAristote confĂ©ra un grand succĂšs Ă cette traduction. Pour corser le tout, le De mineralibus dâAvicenne circula Ă©galement comme un traitĂ© Ă part entiĂšre, sĂ©parĂ© des MĂ©tĂ©orologiques.
Il existe en outre une autre traduction, intĂ©grale, des MĂ©tĂ©orologiques dâAvicenne (et non dâAristote), rĂ©alisĂ©e vers 1270 par JuĂĄn GonzĂĄlez, avec lâaide du Juif Salomon, Ă la demande de lâĂ©vĂȘque de Burgos87.
Lâutilisation par Vincent de Beauvais
Les MĂ©tĂ©orologiques dâAristote sont citĂ©s abondamment dans les livres de la version bifaria qui sont conservĂ©s. Ce sont surtout les livres I, II et III, mais on trouve Ă©galement des citations du De mineralibus. Concernant lâalchimie, seul le De mineralibus est citĂ©, sous les marqueurs in libro quarto metheorum Aristotilis in additis et ex quarto libro metheororum in additis. On lit 4 citations du De mineralibus, dont 3 portant de prĂšs ou de loin sur lâalchimie88 :
-
Bif., 5, 49d89 (= SN, 5, 80d, qui correspond Ă une partie de SN, 7, 79b â Bif., 5, 96a) : chapitre De lapidibus qui ex aquis fiunt (= SN, 5, 80).
-
Bif., 5, 79b (= SN, 7, 2a â SD, 11, 109a1) : chapitre De mineris terre (= SN, 7, 1-2).
-
Bif., 5, 96a1 (= SN, 7, 79b, dont un partie se retrouve en SN, 5, 80d â Bif., 5, 49d) : chapitre De lapidibus mineralibus ;
Bif., 5, 96a2 (= SN, 7, 80a â SD, 11, 123b).
Dans la version trifaria, le corpus des citations des Meteora est Ă©largi ; les MĂ©tĂ©orologiques dâAristote et le De mineralibus sont une des bases thĂ©oriques importantes pour Vincent de Beauvais dans le sujet de la minĂ©ralogie et de lâalchimie. Pour le livre III des MĂ©tĂ©orologiques (= 3Met), Vincent de Beauvais utilise la traduction de GĂ©rard de CrĂ©mone. Pour le livre IV, il cite la version dâHenri Aristippe90. Pour le De mineralibus, il reprend la traduction dâAlfred de Sareshill (cf. infra). Les citations portant sur lâalchimie que Vincent de Beauvais attribue aux Meteora sont au nombre de 24 (19 dans le SN, 5 dans le SD). Parmi elles, le livre III est citĂ© 2 fois, uniquement dans le Speculum naturale, le livre IV est citĂ© 5 fois, uniquement dans le Speculum naturale, et le De mineralibus est citĂ© 19 fois (14 dans le SN et 5 dans le SD)91. La situation est assez complexe. Les livres III et IV des MĂ©tĂ©orologiques dâAristote ne sont jamais citĂ©s dans le Speculum doctrinale au sujet de lâalchimie (câest-Ă -dire dans les citations prises en compte ici) : seul le De mineralibus dâAvicenne est citĂ© Ă la fois dans les extraits traitĂ©s du Speculum naturale et du Speculum doctrinale. Les citations des Meteora relevĂ©es se trouvent dans le livre V (1 citation) et dans le livre VII du Speculum naturale, et dans le livre XI du Speculum doctrinale. Les marqueurs utilisĂ©s sont les suivants :
-
pour le livre III des Météorologiques : Aristoteles in libro IIIo meteororum ;
-
pour le livre IV des Météorologiques et le De mineralibus, on trouve deux types de marqueurs :
-
Aristoteles in libro quarto meteororum, Aristoteles ubi supra libro IVo, Ex libro IVo meteororum, Ex libro IVo metheororum, Ex libro meteororum quarto, Ex libro meteororum IVo, Ex libro IVo, Idem in libro IVo ;
-
Ex additis libri quarti meteororum, Ex additis IVi libri meteororum Aristotelis, Ex additis quarti libri meteororum.
Sous le premier marqueur (1) se retrouvent uniquement les citations du livre III des MĂ©tĂ©orologiques. Pour le second (2), on sâattendrait Ă voir le livre IV des MĂ©tĂ©orologiques sous Aristoteles in libro quarto meteororum (a) et le De mineralibus citĂ© sous lâintitulĂ© Ex additis libri quarti meteororum (b) (= 4MetA), puisque le De mineralibus est prĂ©cisĂ©ment un ajout au livre IV des MĂ©tĂ©orologiques dâAristote, mais ce nâest pas exactement le cas. On remarque que le Speculum doctrinale, qui cite uniquement le De mineralibus dans les citations examinĂ©es ici, le fait toujours sous lâintitulĂ© Ex additis libri quarti meteororum. Dans le Speculum naturale, si le livre IV des MĂ©tĂ©orologiques est toujours mentionnĂ© sous lâintitulĂ© qui lui correspond (a), le De mineralibus, en revanche, est citĂ© sous lâintitulĂ© correct Ex additis libri quarti meteororum (b, i.e. 4MetA) dans le livre V, mais est citĂ© sous le marqueur Aristoteles in libro quarto meteororum (a) dans tout le livre VII. En outre, le livre VII du Speculum naturale contient deux citations composites (SN, 7, 24a et SN, 7, 40b), câest-Ă -dire des extraits qui contiennent des passages du livre IV des MĂ©tĂ©orologiques et du De mineralibus, toutes les deux intitulĂ©es selon le livre IV (a). Ces marqueurs se retrouvent dans le manuscrit du Speculum naturale Paris, BnF, Lat. 14387 et dans le manuscrit du Speculum doctrinale Paris, BnF, Lat. 16100. Dans la version bifaria, on lit dĂ©jĂ le marqueur in libro III° metheororum Aristotilis in additis (Bif., 5, 49d, Bif., 5, 79b, Bif., 5, 96a) et ex quarto libro metheororum in additis (Bif., 5, 63c). Ainsi, Vincent de Beauvais savait que lâattribution Ă Aristote de la fin du livre IV des MĂ©tĂ©orologiques Ă©tait mise en doute par certains (Albert le Grand, par exemple92).
Ă cette discussion sâajoute un passage de lâActor (cf. ci-dessous p. 35), Ă la fin de la citation SN, 7, 85a, câest-Ă -dire dans le chapitre sur la question de la possibilitĂ© de la transmutation (Quod vere fiat eorum transmutatio vel potius disgregatio per alchymiam) :
« (...) Quelques-uns Ă©galement disent que ce dernier chapitre des MĂ©tĂ©ores, dans lequel il est question de la transmutation des mĂ©taux, nâest pas dâAristote, mais un ajout (tirĂ©) des propos dâun autre auteur. »93
Cette derniĂšre phrase sur lâattribution des MĂ©tĂ©orologiques ne se trouve toutefois pas dans lâextrait du Speculum doctrinale correspondant, le SD, 11, 106a, tant dans lâĂ©dition de Douai que dans le manuscrit Paris, BnF, Lat. 16100, alors quâon le retrouve dans tous les tĂ©moins examinĂ©s du Speculum naturale94 (cf. annexe).
Ce faisceau dâindices semble indiquer que, lors de la compilation du livre VII du Speculum naturale et des livres XI et XV du Speculum doctrinale, le travail sur les citations du livre IV des MĂ©tĂ©orologiques et du De mineralibus a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© par diffĂ©rents socii95. Les citations du De mineralibus dans le Speculum doctrinale sont intitulĂ©es de la mĂȘme maniĂšre que dans la bifaria, câest-Ă -dire considĂ©rĂ©es comme un ajout au livre IV des MĂ©tĂ©orologiques, tandis que celles du livre VII du Speculum naturale sont toutes considĂ©rĂ©es comme des extraits authentiques : les socii qui ont travaillĂ© sur le livre VII du Speculum naturale ignoraient probablement que la fin du livre IV des MĂ©tĂ©orologiques Ă©tait sujette Ă caution, ce qui a provoquĂ© lâerreur de marqueurs. La glose de lâActor pour prĂ©ciser que lâattribution est douteuse aura Ă©tĂ© ajoutĂ©e lors de la rĂ©vision du livre VII du Speculum naturale (peut-ĂȘtre par Vincent de Beauvais lui-mĂȘme) ; et puisque les marqueurs du Speculum doctrinale Ă©taient les bons, la glose nâĂ©tait pas nĂ©cessaire dans le Speculum doctrinale. Cependant, il ne sâagit que dâune hypothĂšse, et la prĂ©sence de marqueurs ex additis libri quarti meteororum dans le livre V oblige Ă supposer dans ce cas que le livre VII et le livre V du Speculum naturale ont Ă©tĂ© compilĂ©s par diffĂ©rents socii.
Vincent de Beauvais utilise principalement les livres III et IV des MĂ©tĂ©orologiques ainsi que le De mineralibus dans les descriptions de substances, mais aussi quelques fois dans les descriptions dâopĂ©rations alchimiques sur ces substances. Il traite diffĂ©remment les citations. Les citations du livre III des MĂ©tĂ©orologiques sont trĂšs peu littĂ©rales, elles sont toutes les deux trĂšs rĂ©sumĂ©es ; cependant, les expressions citĂ©es sont bien composĂ©es des mĂȘmes mots que la traduction de GĂ©rard, il nây a donc pas de doute quant Ă la version utilisĂ©e (cf. annexe). Il en va de mĂȘme pour le livre IV des MĂ©tĂ©orologiques : Vincent de Beauvais rĂ©sume fortement le texte. Il synthĂ©tise parfois plusieurs pages en quelques lignes (par exemple en SN, 7, 24b1). En revanche, le De mineralibus nâest pas abrĂ©gĂ©Â ; il est citĂ© trĂšs littĂ©ralement Ă lâexception du passage SN, 7, 40b2. Au sujet du De mineralibus, il faut prĂ©ciser que le texte nâa jamais Ă©tĂ© Ă©ditĂ© de façon critique96 ; pour identifier les citations, jâai utilisĂ© la version Ă©ditĂ©e par Holmyard et Mandeville97, qui est une Ă©dition diplomatique du manuscrit Cambridge, Trinity College, O. 8-25 (ou ms. 1400), du XVe siĂšcle, avec les variantes dâautres manuscrits en apparat. En identifiant les extraits du Speculum maius, jâai remarquĂ© que Vincent de Beauvais utilisait une version du De mineralibus qui Ă©tait plus proche de celle prĂ©sente dans le manuscrit Cambridge, Trinity College, O. 2-18 (ou ms. 1122), Ă©galement du XVe siĂšcle, donnĂ© en apparat par Holmyard et Mandeville (sigle TB), et parfois Ă©galement de lâĂ©dition de Bologne98 (sigle B). Ces rapprochements ne sont cependant pas significatifs, car les manuscrits pris en compte par Holmyard et Mandeville sont fort tardifs. Afin de permettre au lecteur dâobserver les liens entre le De mineralibus et le texte de Vincent de Beauvais, jâai changĂ© la version Ă©ditĂ©e par Holmyard et Mandeville en prenant dans lâapparat les leçons qui sâapparentent Ă celles de Vincent de Beauvais, et jâai parfois corrigĂ© le texte quand il sâagit dâerreurs Ă©videntes : tout changement est notĂ© par le soulignement du texte. Il ne sâagit donc pas dâune Ă©dition critique, mais uniquement dâun choix de leçons permettant de voir le lien entre le De mineralibus et le texte de Vincent de Beauvais, en attendant une Ă©dition critique valable du De mineralibus. Jâai Ă©galement insĂ©rĂ© dans le texte une ponctuation rudimentaire.
Vincent de Beauvais cite Ă plusieurs reprises le Sciant artifices, un passage du De mineralibus trĂšs dĂ©battu au Moyen Ăge, dans lequel Avicenne (considĂ©rĂ© comme Aristote par Vincent de Beauvais, avec la rĂ©serve mentionnĂ©e ci-dessus) se prononce contre la possibilitĂ© de transmuter les espĂšces99 : dans le SN, 7, 42a, dans un chapitre consacrĂ© aux opĂ©rations sur le plomb, et dans la citation SN, 7, 84b â SD, 11, 131b, câest-Ă -dire dans le chapitre portant sur la modalitĂ© de la transmutation dans le Speculum naturale (Qualiter per hunc lapidem fiat metallorum transmutatio secundum quosdam) et dans le Speculum doctrinale (Qualis fiat per elixir metallorum transmutatio, secundum quosdam). Enfin, il y est fait allusion dans la glose de lâActor qui a Ă©tĂ© citĂ©e ci-dessus, en mentionnant que certains affirment quâil ne sâagit pas dâun passage authentique dâAristote. Il est Ă©galement intĂ©ressant et amusant de voir que cette glose est suivie dans le Speculum naturale dâune citation du De anima alchimique (SN, 7, 85b â SD, 11, 106b1) dans laquelle le pseudo-Avicenne dĂ©fend la possibilitĂ© de la transmutation : ainsi, Vincent de Beauvais propose un texte quâil pense ĂȘtre dâAvicenne (le De anima alchimique) comme opinion contraire Ă un texte quâil pense ĂȘtre dâAristote (mais lâattribution est mise en doute, glose-t-il), mais il utilise en rĂ©alitĂ© le pseudo-Avicenne (le De anima alchimique) pour mettre en contraste les propos du vĂ©ritable Avicenne (le De mineralibus).
Les citations SD, 11, 109a et SD, 11, 120a regroupent chacune plusieurs citations du livre VII du Speculum naturale, au contraire des citations Speculum doctrinale, 11, 123b et SD, 11, 131b, qui correspondent chacune à une citation dans le livre VII du Speculum naturale, bien que le texte des deux versions soit un peu différent.
En SN, 7, 75c â SD, 11, 109a4, Vincent de Beauvais change lĂ©gĂšrement le texte en fin de passage, ce qui cause un contresens.
La citation SN, 7, 80a â SD, 11, 123b â SD, 15, 64b prĂ©sente des leçons particuliĂšres. On observe dans le Speculum doctrinale (deux fois) que les lieux gĂ©ographiques sont tous suivis dâun alias puis dâune autre leçon ; ces ajouts ne se retrouvent pas dans le manuscrit du Speculum doctrinale Paris, BnF, Lat. 16100. En outre, lâĂ©dition de Douai propose au milieu de lâextrait le mot Persia dans le Speculum naturale et Parthica alias Parthia dans le Speculum doctrinale : les leçons Parthia et Persia se trouvent toutes les deux dans les manuscrits du De mineralibus 100. Le manuscrit du Speculum naturale Paris, BnF, Lat. 14387 comporte quant Ă lui Parthica, et le manuscrit du Speculum doctrinale Paris, BnF, Lat. 16100 note Pertica. Cette observation est dâimportance pour lâĂ©tablissement de lâhistoire du texte de lâĂ©dition de Douai, qui est tributaire de lâĂ©dition de Strasbourg de 1476.
Le livre IV des Météorologiques comme source interne
Le livre IV des Météorologiques est cité de maniÚre indirecte dans les citations du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham sous le marqueur Liber de natura/is rerum en SN, 6, 82a2 et SN, 6, 83a.
Le Liber de natura rerum
Les traités
Quand il cite le Liber de natura rerum au sujet de lâalchimie, Vincent de Beauvais se rĂ©fĂšre sans les distinguer Ă deux Ćuvres : le Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© (= LDNRTh), et le Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham101 (= LDNRFo).
Le Liber de natura rerum est une encyclopĂ©die en 19 livres rĂ©digĂ©e durant quinze annĂ©es par le dominicain Thomas de CantimprĂ©102, terminĂ©e aux alentours de 1237-1240. Il y eut au moins trois versions successives du vivant mĂȘme de lâauteur : ces recensions sont appelĂ©es Thomas I, II (en 20 livres, complĂ©tĂ©e avant 1240) et III (difficile Ă dater prĂ©cisĂ©ment)103. Son Ćuvre a joui dâun succĂšs considĂ©rable, en particulier les passages relatifs aux animaux.
Le Liber de naturis rerum est une encyclopĂ©die moralisĂ©e104 faussement attribuĂ©e Ă John Folsham (1300-1348), un carmĂ©lite anglais, et probablement rĂ©digĂ©e entre 1220 et 1240, mais cette datation est relative car elle ne repose que sur les sources de lâouvrage. Une seule version est signalĂ©e dans cinq manuscrits, tous incomplets.
Deux hypothĂšses apparaissent. Il pourrait sâagir de deux traitĂ©s distincts que Vincent de Beauvais cite sous le mĂȘme marqueur, mais lâhypothĂšse est peu probante, car ce nâest pas dans les habitudes du dominicain, et il faudrait alors supposer une erreur des socii. La seconde hypothĂšse, beaucoup plus vraisemblable, est que Vincent de Beauvais possĂ©dait un manuscrit intitulĂ© Liber de natura/is rerum qui contenait un texte composĂ© Ă la fois du Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© et du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham. Ă cette hypothĂšse sâajoute le cas du manuscrit Bernkastel-Kues, Bibliothek des Sint-Nikolaus-Hospitals, Cusanus 203 (fin XIIIe s.), dans lequel se trouve une version incomplĂšte du Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© (ff. 3r-78r) Ă laquelle sont ajoutĂ©s quelques passages du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham (ff. 78v-84v) ; ce manuscrit nâest pas celui utilisĂ© par Vincent de Beauvais, car le dominicain cite le Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© presque intĂ©gralement, mais lâexemple du Cusanus 203 montre que des versions contenant Ă la fois le Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© et le Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham circulaient. En outre, une citation de lâActor en SD, 15, 32b semble indiquer que Vincent de Beauvais utilisait une compilation105 : câest peut-ĂȘtre du Liber de natura/is rerum quâil sâagit, ou encore du Philosophus (cf. ci-dessous p. 32).
Le marqueur Liber de natura/is rerum semble avoir des liens avec le Philosophus, car plusieurs passages de ce dernier sont Ă©galement des citations des Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© et Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham. La citation SN, 7, 36c â SD, 15, 60b2 en particulier est attribuĂ©e au Liber de natura/is rerum dans le Speculum naturale et au Philosophus dans le Speculum doctrinale (cf. ci-dessous p. 32).
En Ă©tudiant le Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham, jâai identifiĂ© des citations internes, dont certaines nâont pas Ă©tĂ© remarquĂ©es par Abramov106 :
-
trois citations assez littĂ©rales de la version G De aluminibus et salibus, toutes rĂ©pertoriĂ©es par Abramov : SN, 6, 79c1 ; SN, 7, 24a1 â SD, 15, 60a1 ; SN, 7, 26c1 ; SN, 7, 38d ;
-
deux citations trĂšs rĂ©sumĂ©es du livre IV des MĂ©tĂ©orologiques, quâAbramov a partiellement retrouvĂ©es : SN, 6, 82a2 ; SN, 6, 83a.
-
quatre citations assez littĂ©rales des Quaestiones Nicolai Peripatetici (cf. ci-dessous p. 31), dont Abramov ignorait lâutilisation par le pseudo-John Folsham : SN, 6, 79c2 ; SN, 7, 7b3 ; SN, 7, 18d2 ; SN, 7, 52a.
En outre, les citations du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham portant sur lâalchimie qui sont reprises par Vincent de Beauvais comportent une citation interne du Circa instans (SN, 7, 61f), identifiĂ©e par Abramov (cf. annexe).
Lâutilisation par Vincent de Beauvais
Le Liber de natura rerum est citĂ©Â 3 fois dans les livres de la version bifaria qui sont conservĂ©s, aux chapitres De iacincto et iunco et iusquiamo (Bif., 6, 40f), De tamarice et taxo et terebinto (Bif., 7, 49j) et De vite (Bif., 7, 51f), mais jamais au sujet de lâalchimie.
Dans les passages de la version trifaria concernant lâalchimie, le marqueur Liber de natura/is rerum est citĂ© 21 fois (15 dans le SN, 6 dans le SD). Parmi ces citations, le Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© est citĂ© 5 fois dans le Speculum naturale, et 5 fois dans le Speculum doctrinale107, et le Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham est citĂ© 9 fois dans le Speculum naturale, et 1 fois dans le Speculum doctrinale108. A cela, il faut ajouter une citation composite dans le Speculum naturale, qui contient Ă la fois un passage du Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© et un passage du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham (SN, 7, 7b). Ces citations se retrouvent dans les livres 6 et 7 du Speculum naturale et dans le livre XV du Speculum doctrinale (jamais dans le livre XI). Les marqueurs, utilisĂ©s indistinctement, sont : Ex libro de natura rerum (le seul utilisĂ© dans le Speculum doctrinale), Ex libro de naturis rerum. En outre, les citations dans le Speculum doctrinale sont presque toutes tirĂ©es du Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ©, Ă lâexception de SD, 15, 60a. Il faut ajouter Ă lâinverse que, quand le Speculum naturale contient une citation sur lâalchimie marquĂ©e Liber de natura/is rerum qui nâest pas reprise dans le Speculum doctrinale, il sâagit alors toujours du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham.
Le Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© est principalement utilisĂ© par Vincent de Beauvais pour des descriptions de substances. Les citations sont littĂ©rales. Une citation dans le Speculum doctrinale (SD, 15, 58a, partiellement reprise en SN, 7, 7b1) comporte des extraits littĂ©raux dont lâordre a Ă©tĂ© modifiĂ©Â : on peut identifier trois segments dans la citation (cf. annexe). Le Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© citĂ© par Vincent de Beauvais correspond au Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© Ă©ditĂ© par Boese, mais il est difficile de se prononcer prĂ©cisĂ©ment entre Thomas I et Thomas II, bien que les identifications semblent indiquer plutĂŽt lâutilisation de Thomas I109.
Vincent de Beauvais a recours au Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham principalement dans des descriptions de substances et dans des descriptions dâopĂ©rations qui sây rapportent. Les citations de cet ouvrage sont gĂ©nĂ©ralement littĂ©rales, mais montrent clairement un travail de rĂ©organisation. Cette rĂ©organisation pourrait ĂȘtre le fait de Vincent de Beauvais et de ses collaborateurs ou bien de lâauteur de la compilation quâil a utilisĂ©e.
Dans le passage SN, 7, 18d2, lâintroduction dâun non dans le texte du Speculum naturale introduit un contresens.
Le Liber de natura rerum de Thomas de Cantimpré et le Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham comme sources internes
Le Liber de natura rerum de Thomas de Cantimpré et le Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham sont cités sous le marqueur Philosophus.
Le Liber de vaporibus attribué à AverroÚs
Le traité
Quand Vincent de Beauvais cite un Liber de vaporibus (= DVap) quâil attribue Ă AverroĂšs, il sâagit en rĂ©alitĂ© dâun traitĂ© mieux connu sous le nom de Quaestiones Nicolai Peripatetici (= QNP)110. Les Quaestiones Nicolai Peripatetici sont un ouvrage pseudĂ©pigraphique contenant diverses quaestiones relatives Ă la philosophie de la nature, qui est attribuĂ© Ă Michel Scot par Albert le Grand dans son commentaire aux MĂ©tĂ©orologiques dâAristote111, et Ă AverroĂšs par Gilbert lâAnglais dans son Compendium medicinae et par Vincent de Beauvais dans son Speculum maius. Dans les manuscrits du texte112, le traitĂ© est attribuĂ© une fois Ă Nicolas le PĂ©ripatĂ©ticien, une fois Ă Alpharabi, câest-Ă -dire le philosophe AbĆ« NaáčŁr al-FÄrÄbÄ«, une fois Ă Avicenne, et une fois Ă AverroĂšs (sous le titre De vi informativa, copie ne contenant que les deux chapitres sur la physiognomonie), les autres copies Ă©tant anonymes. StanisĆaw Wielgus Ă©carte les hypothĂšses dâattribution Ă tous ces auteurs Ă lâexception de Michel Scot, tout en gardant une rĂ©serve, car Michel Scot est le traducteur de plusieurs Ćuvres dâAverroĂšs. Il semble plus prudent de considĂ©rer lâouvrage comme anonyme. Wielgus observe que les Quaestiones Nicolai Peripatetici apparaissent dans la plupart des manuscrits parmi des Ćuvres dâAverroĂšs, et que le contenu des Quaestiones Nicolai Peripatetici est influencĂ© de maniĂšre directe par un passage du commentaire dâAverroĂšs Ă la MĂ©taphysique dâAristote, et de maniĂšre indirecte par tout le livre XII de cette Ćuvre : il Ă©met lâhypothĂšse dây voir les causes, entre autres, de lâattribution Ă AverroĂšs chez Vincent de Beauvais et Gilbert lâAnglais113. La datation du traitĂ© semble indiquer le XIIIe siĂšcle, elle se situe entre la composition du commentaire dâAverroĂšs (1126-1198) Ă la MĂ©taphysique dâAristote, qui est citĂ© dans les Quaestiones Nicolai Peripatetici, et la rĂ©daction du Compendium medicinae (c. 1230-1240) de Gilbert lâAnglais.
Lâutilisation par Vincent de Beauvais
Les Quaestiones Nicolai Peripatetici nâapparaissent pas dans les livres de la version bifaria qui sont conservĂ©s.
Les passages relatifs Ă lâalchimie dans les Quaestiones Nicolai Peripatetici reprĂ©sentent 10 citations chez Vincent de Beauvais, toujours dans le livre VII du Speculum naturale114. Les Quaestiones Nicolai Peripatetici ne sont jamais citĂ©es dans le Speculum doctrinale, y compris Ă propos dâautres sujets que lâalchimie : le fait est important, mais difficile Ă interprĂ©ter. Les marqueurs sont : Averroes ex libro de vaporibus, Ex libro Averrois de vaporibus, Ex libro de vaporibus. Vincent de Beauvais utilise principalement les Quaestiones Nicolai Peripatetici dans la description dâopĂ©rations sur diverses substances. Ătonnamment, les citations des Quaestiones Nicolai Peripatetici sont souvent plus techniques que celles du De anima alchimique et du De aluminibus et salibus : Vincent de Beauvais utilise les parties les plus thĂ©oriques du De anima et du De aluminibus et salibus, mais nâhĂ©site pas Ă puiser dans les explications thĂ©oriques dâobservations pratiques que proposent les Quaestiones Nicolai Peripatetici, ce qui leur donne un aspect plus technique dans le Speculum naturale. Les citations des Quaestiones Nicolai Peripatetici sont toujours assez littĂ©rales, quoique trĂšs sĂ©lectives (par exemple en SN, 7, 94a).
Les Quaestiones Nicolai Peripatetici comme source interne
Jâai pu identifier diffĂ©rentes citations internes non marquĂ©es des Quaestiones Nicolai Peripatetici dans des passages du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham citĂ©s sous le marqueur Liber de natura/is rerum, (cf. p. 28 et infra).
Le Philosophus
Le traité
Le marqueur Philosophus, souvent utilisĂ© par les auteurs mĂ©diĂ©vaux (tant latins quâarabes) pour dĂ©signer Aristote (voire Avicenne ou AverroĂšs), a en outre un sens plus particulier chez Vincent de Beauvais. On retrouve ce terme pour Ă©voquer proprement Aristote dans le Speculum naturale, souvent avec une prĂ©cision (par exemple en SN, 4, 1c, Philosophus in metheorum libro Io). Mais quand on trouve le marqueur Philosophus seul, il ne dĂ©signe pas seulement Aristote, mais cache Ă©galement dâautres auteurs.
Quand Vincent de Beauvais cite le Philosophus au sujet de lâalchimie, il sâagit :
-
de citations littĂ©rales du Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ©Â : SN, 7, 24d â SD, 15, 60b1 ; SN, 7, 36c â SD, 15, 60b2 ; SN, 7, 52c â SD, 15, 63b.
-
de citations littĂ©rales du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham : SN, 7, 41b ; SN, 7, 54c ; ces citations du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham contiennent elles-mĂȘmes des citations qui sont mentionnĂ©es ci-dessous et dans lâannexe I pour les raisons susdites :
-
deux citations de la version G De aluminibus et salibus, identifiées par Abramov : SN, 7, 41b1 ; SN, 7, 54c1 ;
-
une citation des Quaestiones Nicolai Peripatetici, non identifiée par Abramov : SN, 7, 41b3 ;
-
une citation du livre XXXII (Liber fornacis) du Liber de Septuaginta de Geber115, identifiée par Abramov : SN, 7, 54c2 ;
-
dâune citation du Liber regalis, la Practica, lib. II, c. 46-47 de Hali, câest-Ă -dire du KitÄb kÄmil al-áčŁinÄâa al-áčabÄ«âiyya (Livre complet sur lâart mĂ©dical), plus connu sous le titre dâal-MalakÄ« (Le royal) ou KitÄb al-malakÄ« (Livre du royal) de âAlÄ« ibn al-âAbbÄs al-MajĆ«sÄ«, selon sa traduction par Ătienne dâAntioche116 : SN, 7, 75b. Cette citation se retrouve citĂ©e sous le nom Hali117 en SD, 15, 65c.
Il est Ă©tonnant au premier abord dâobserver ces extraits sous le marqueur Philosophus, car le Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ©, le Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham et le Liber regalis sont des textes que Vincent de Beauvais utilise par ailleurs, sous les marqueurs Liber de natura/is rerum (cf. ci-dessus p. 28) et Hali. Les citations du Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© et du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham soulignent une proximitĂ© entre le Liber de natura/is rerum et le Philosophus dans le domaine de lâalchimie, mais la citation du Liber regalis montre quâil sâagit de deux textes distincts. Ă cela sâajoute que le nom Philosophus se trouve utilisĂ© comme marqueur dans le manuscrit Oxford, Corpus Christi College, 221 (dĂ©but du XIVe s.) du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham, notamment pour des citations reprises dans le Speculum maius et marquĂ©es Philosophus (dont certaines parmi les citations analysĂ©es).
Si on trouve 94 fois (relevĂ© exhaustif, non plus seulement au sujet de lâalchimie) le Philosophus seul (câest-Ă -dire sans ajout du type in libro IIIo Metheorum) dans le Speculum naturale, on ne lâobserve que 2 fois seul dans le Speculum doctrinale (relevĂ© exhaustif). Ces deux citations du Philosophus dans le Speculum doctrinale, qui se trouvent Ă©galement dans le Speculum naturale, sont des citations littĂ©rales du Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© qui portent sur la description des mĂ©taux (SD, 15, 60b qui correspond Ă SN, 7, 24d et SN, 7, 36c ; et SN, 7, 52c â SD, 15, 63b). Les autres extraits alchimiques et minĂ©ralogiques du Philosophus, qui ne sont pas du Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ©, sont uniquement citĂ©s dans le Speculum naturale.
La citation SD, 15, 60b prĂ©sente un cas pertinent pour la discussion : SN, 7, 24d â SD, 15, 60b1 est citĂ© sous le marqueur Philosophus dans les deux passages ; et SN, 7, 36c â SD, 15, 60b2 est citĂ© sous le marqueur Liber de natura/is rerum dans le Speculum naturale et sous Philosophus dans le Speculum doctrinale. Le manuscrit du Speculum naturale Paris, BnF, Lat. 14387 confirme le marqueur ex libro de natura rerum, mais le manuscrit du Speculum doctrinale Paris, BnF, Lat. 16100 omet la citation SD, 15, 60a (et non b) ainsi que le marqueur de la citation SD, 15, 60b, en raison dâun saut du mĂȘme au mĂȘme118. Je nâai donc pas pu vĂ©rifier le marqueur du Speculum doctrinale ailleurs que dans lâĂ©dition de Douai119. Toutefois, il ne sâagit probablement pas dâun simple oubli de marqueur, car le Liber de natura/is rerum est citĂ© en SD, 15, 60a, câest-Ă -dire dans le mĂȘme chapitre 60 : Vincent de Beauvais aurait alors citĂ© dans un seul chapitre le Liber de natura/is rerum, puis le Philosophus, puis Ă nouveau le Liber de natura/is rerum, ce quâil ne fait pas habituellement. Pour compliquer encore le tout, le passage SN, 7, 36c â SD, 15, 60b2 comporte lui-mĂȘme une citation du Liber de lumine luminum pseudo-aristotĂ©licien qui est attribuĂ©e Ă Aristote dans le Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ©Â : le Speculum doctrinale copie fidĂšlement ce marqueur interne, de mĂȘme que le manuscrit du Speculum naturale Paris, BnF, Lat. 14387, mais lâĂ©dition de Douai du Speculum naturale note Philosophus au lieu dâAristoteles comme source interne (cf. annexe).
Aux donnĂ©es prĂ©sentĂ©es ci-dessus sâajoutent celles recueillies par Eduard Frunzeanu lors de sa thĂšse de doctorat120 : un extrait du Philosophus (SN, 5, 20b) cite un certain Alvredus, qui pourrait ĂȘtre Alfred de Sareshill ; plusieurs extraits du Philosophus sont des citations de la Summa de anima de Jean de La Rochelle et du De anima et potenciis eius dâun maĂźtre Ăšs arts anonyme (c. 1225). Eduard Frunzeanu remarque Ă©galement les citations du Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© et des Quaestiones Nicolai Peripatetici121.
Le Philosophus seul nâest jamais citĂ© dans les huit livres conservĂ©s de la version bifaria.
Ainsi, diffĂ©rentes hypothĂšses se prĂ©sentent. 1) Comme il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© dit, Vincent de Beauvais ne dĂ©signe que trĂšs rarement ses contemporains par leur nom, le Philosophus pourrait donc ĂȘtre un nom gĂ©nĂ©rique utilisĂ© pour dĂ©signer des ouvrages dâauteurs contemporains Ă Vincent de Beauvais. 2) Le nom Philosophus pourrait ĂȘtre un marqueur renvoyant Ă une compilation de diffĂ©rents textes. Câest cette derniĂšre hypothĂšse qui semble la plus vraisemblable, en raison de lâutilisation du marqueur Philosophus dans le manuscrit du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham dont il a Ă©tĂ© question plus haut : le Philosophus serait alors une des sources du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham et de Vincent de Beauvais. Il est peut-ĂȘtre Ă©galement une des sources du Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ©, ou bien le Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© est une des sources de la compilation du Philosophus, ce qui placerait dans ce cas la date de rĂ©daction de cette compilation aprĂšs 1237. La citation du Liber regalis va aussi dans le sens de la deuxiĂšme hypothĂšse. Il est improbable que Vincent de Beauvais cite le Philosophus de maniĂšre indirecte Ă partir du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham pour les citations qui sây retrouvent, car le Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© ne comporte jamais le marqueur Philosophus.
Le fait que Vincent de Beauvais ne cite le Philosophus seul que 2 fois dans le Speculum doctrinale contre 94 dans le Speculum naturale, Ă lâinstar des Quaestiones Nicolai Peripatetici qui ne sont citĂ©es que dans le Speculum naturale, nâest pas anodin, mais reste difficile Ă interprĂ©ter.
Lâutilisation par Vincent de Beauvais
Au sujet de lâalchimie, le Philosophus est citĂ©Â 7 fois (5 dans le SN, et 2 dans le SD), sous lâunique marqueur Philosophus. Tous les extraits du Speculum naturale sont dans le livre VII, et ceux du Speculum doctrinale dans le livre XV (et non dans le livre XI), dans les chapitres consacrĂ©s aux mĂ©taux. Comme il a Ă©tĂ© dit, les deux extraits du Speculum doctrinale sont des citations littĂ©rales du Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ©. Le Philosophus est principalement utilisĂ© par Vincent de Beauvais pour des descriptions minĂ©ralogiques, mais aussi pour la description des opĂ©rations alchimiques sur le fer (SN, 5, 54c).
Au sujet des citations du Philosophus qui sont des extraits du Liber de natura rerum de Thomas de Cantimpré et du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham, le traitement est identique à celles placées sous le marqueur Liber de natura/is rerum (cf. ci-dessus p. 28).
Les citations de lâActor
Les citations analysĂ©es ne permettent pas dâapporter de nouveaux Ă©lĂ©ments Ă la question de la paternitĂ© des citations de lâActor, je me contente donc de renvoyer le lecteur aux Ă©tudes consacrĂ©es Ă ce sujet122. Ces citations sont le plus souvent considĂ©rĂ©es comme des passages rĂ©digĂ©s par Vincent de Beauvais, mais la question reste ouverte. LâActor intervient 12 fois concernant lâalchimie (5 dans le SN, 7 dans le SD). Deux citations sont reprises Ă la fois dans le Speculum naturale et le Speculum doctrinale (SN, 7, 84a â SD, 11, 131a, et SN, 7, 85a â SD, 11, 106a).
En plusieurs passages, lâActor donne des prĂ©cisions sur la structure de lâouvrage (en SN, 7, 6c ; SD, 15, 65a ; et SN, 15, 65d).
Dans certaines citations, lâActor reprend des passages dĂ©jĂ citĂ©s ou rĂ©sume des extraits plus longs. Ainsi, en SN, 7, 63b, il met en perspective lâextrait des MĂ©tĂ©orologiques dâAristote citĂ© en SN, 7, 63a avec une phrase du De aluminibus et salibus quâil donne alors partiellement et qui se trouve Ă©galement en SN, 7, 62a â SD, 11, 119b. En SN, 7, 67b, il reprend un passage de la Doctrina alchimiae/ Alchimista citĂ© en SN, 7, 60b1 â SD, 11, 105d1 aprĂšs avoir proposĂ© une conclusion tirĂ©e des chapitres 63, 66 et 67 sur le vif-argent et le soufre (le vif-argent et le soufre sont la base des mĂ©taux). Dans la citation SN, 7, 84a â SD, 11, 131a, il rĂ©sume les chapitres SN, 81-83 et SD, 129-130. Il faut prĂ©ciser que cette citation est marquĂ©e glossa dans le Speculum naturale et non Actor, mais la raison semble ĂȘtre que la citation du Speculum naturale suit directement la glossa de lâEpistola ad Hasen regem de re tecta dont il Ă©tĂ© question plus haut (cf. ci-dessus p. 20) : le marqueur aura Ă©tĂ© confondu.
La citation SN, 7, 85a â SD, 11, 106a a dĂ©jĂ Ă©tĂ© traitĂ©e plus haut, au sujet du livre IV des MĂ©tĂ©orologiques (cf. ci-dessus 22).
Enfin, la citation SD, 11, 105a contient un passage dans lequel lâActor se positionne sur la place de lâalchimie dans la classification des sciences, en citant Richard de Saint Victor. Cette citation a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e par Jean-Marc Mandosio123.
Conclusion
Outre la classification des sources alchimiques de Vincent de Beauvais proposĂ©e dans ce dossier, Ă savoir une distinction entre les traitĂ©s purement alchimiques et les ouvrages plus gĂ©nĂ©raux, on peut diviser les textes collectĂ©s par le dominicain en deux autres catĂ©gories : les grandes autoritĂ©s, et les ouvrages rĂ©cents de son Ă©poque. Comme pour les autres domaines, il ne se contente jamais dâĂ©voquer les grands noms reconnus, il se soucie Ă©galement de prĂ©senter les derniers Ă©tats du savoir : lâusage constant du Liber de natura rerum de Thomas de CantimprĂ© et du Liber de naturis rerum du pseudo-John Folsham en est un bon exemple. Et comme dans toute encyclopĂ©die, lâauteur sâattache aux grandes idĂ©es de son temps, en lâoccurrence, la thĂ©orie du soufre et du mercure et dâautres de ce genre. Cependant, cette constatation ne doit pas induire une fausse opinion concernant Vincent de Beauvais et son rapport Ă lâalchimie. Ses extraits composent un exposĂ© sur lâalchimie, non pas lâexposĂ© dâun alchimiste ; le dominicain est Ă©tranger aux pratiques, non seulement alchimiques, mais Ă©galement mĂ©tallurgiques. On ne devient pas alchimiste en lisant le Speculum maius, et lĂ nâest pas lâintention de lâencyclopĂ©diste ; il tend plutĂŽt Ă prĂ©senter lâalchimie Ă des frĂšres Ă©rudits quâĂ faire dâeux des adeptes de lâart transmutatoire. Des erreurs de cohĂ©rence sâobservent, Ă©ventuellement dues Ă un manque de connaissance ou Ă un manque dâattention, voire peut-ĂȘtre voulues par souci de littĂ©ralitĂ©Â : le sel ammoniac, par exemple, est classĂ© par le dominicain parmi les esprits (les substances qui se subliment dâelles-mĂȘmes, ou plutĂŽt par la simple action de la chaleur) quand il cite le De anima pseudo-avicennien ou la Doctrina alchimiae, mais se trouve considĂ©rĂ© comme un sel quand câest le De aluminibus et salibus qui est repris124. Vincent de Beauvais nâutilise que peu de traitĂ©s dâalchimie. Il a vraisemblablement lu les textes quâil a trouvĂ©s et les a citĂ©s sans trop se soucier de la prĂ©cision et de la vĂ©racitĂ© de leur contenu. Cette tendance se marque Ă©galement, comme dans les autres encyclopĂ©dies de lâĂ©poque, par une prĂ©sence immodĂ©rĂ©e de la thĂ©orie, et une absence quasi totale de rĂ©fĂ©rences pratiques. Jamais lâauteur ne cite une recette, jamais il ne dĂ©crit une manipulation technique. Et mĂȘme quand il aborde une question plus pratique, câest toujours selon une vision thĂ©orique, pour expliquer un phĂ©nomĂšne, et non pour enseigner comment le rĂ©aliser. Cette omniprĂ©sence de la thĂ©orie constitue le paradoxe de Vincent de Beauvais. Dans sa classification des sciences, il range en effet lâalchimie parmi les arts mĂ©caniques, câest-Ă -dire les arts dont la thĂ©orie, sâil y en a une, est extĂ©rieure Ă eux-mĂȘmes et participe de la philosophie plutĂŽt que de lâart mĂ©canique lui-mĂȘme, comme le dĂ©crit Richard de Saint-Victor en SD, 11, 1a :
« Il faut savoir Ă©galement que la mĂ©canique participe de la philosophie selon sa thĂ©orie, et non selon son exĂ©cution. Par exemple, la thĂ©orie (dans le domaine) de lâagriculture relĂšve du philosophe, son exĂ©cution du paysan. »125
Mais bien quâil affirme cela, Vincent de Beauvais ne prĂ©sente dans son discours sur lâalchimie que des notions thĂ©oriques, câest-Ă -dire, suivant le raisonnement de Richard de Saint-Victor, des notions qui relĂšvent de la philosophie et non de lâalchimie.
Si la minĂ©ralogie prĂ©sentĂ©e dans le Speculum maius est un mĂ©lange entre les donnĂ©es classiques grecques et latines (Pline, Isidore, Aristote) et les nouveautĂ©s arabo-musulmanes (De aluminibus et salibus, De anima, etc.), lâalchimie quâil dĂ©crit est quant Ă elle une science rĂ©cente dans le monde occidental, intĂ©gralement issue des premiĂšres traductions de lâarabe, une alchimie encore pleinement influencĂ©e par les traitĂ©s arabo-musulmans. Le temps de lâalchimie latine Ă part entiĂšre nâest pas encore arrivĂ©, avec ses compositions propres et ses auteurs plus indĂ©pendants vis-Ă -vis des thĂ©ories des alchimistes arabo-musulmans, bien que toujours soumis Ă leur autoritĂ© (dont lâexemple le plus influent est la Summa perfectionis du pseudo-Geber). Câest ainsi Ă une alchimie avant tout jÄbirienne que Vincent de Beauvais fait allusion : les principes transmutatoires dĂ©crits dans son Ćuvre sont basĂ©s sur la thĂ©orie des Ă©lixirs. Toute chose est composĂ©e des quatre Ă©lĂ©ments, eux-mĂȘmes caractĂ©risĂ©s par les propriĂ©tĂ©s Ă©lĂ©mentaires ; toute chose est ainsi dĂ©finie par une proportion de propriĂ©tĂ©s Ă©lĂ©mentaires. Pour opĂ©rer une transmutation, lâalchimiste doit changer cette proportion pour lui donner celle de lâor ou de lâargent. Pour ce faire, il utilise les Ă©lixirs : il divise une substance appelĂ©e pierre en ses quatre Ă©lĂ©ments, et prĂ©pare ces Ă©lĂ©ments de maniĂšre Ă ce quâils ne soient caractĂ©risĂ©s que par une des propriĂ©tĂ©s Ă©lĂ©mentaires ; il rĂ©alise ensuite un mĂ©lange prĂ©cis de propriĂ©tĂ©s Ă©lĂ©mentaires, appelĂ© Ă©lixir, quâil projette sur le mĂ©tal pour en changer la proportion de propriĂ©tĂ©s. A cela sâajoute parfois un ferment, câest-Ă -dire une petite quantitĂ© prĂ©parĂ©e du mĂ©tal dĂ©sirĂ©, or ou argent, qui agit Ă la maniĂšre dâun levain en transformant le mĂ©tal vil en mĂ©tal noble126. Ces Ă©lixirs peuvent ĂȘtre faits avec diverses matiĂšres, au sujet desquelles les alchimistes concordent rarement. De cette doctrine arabe ne transparaĂźt quâun exposĂ© tronquĂ© chez Vincent de Beauvais : les quelques chapitres consacrĂ©s Ă la transmutation (SN, 7, 81-86 et 89-93, et SD, 11, 124-130), presque intĂ©gralement tirĂ©s du De anima et de lâAlchimista, ne prĂ©sentent pas la doctrine complĂšte, mais mentionnent seulement la division en les quatre Ă©lĂ©ments. En outre, la citation de lâAlchimista en SN, 7, 81a â SD, 11, 124a amĂšne une confusion entre la pierre et lâĂ©lixir. Ainsi, il nâest pas possible sur la base seule du Speculum maius de comprendre vĂ©ritablement lâalchimie Ă laquelle Vincent de Beauvais fait allusion.
Je termine cette Ă©tude par une constatation adventice, qui aurait plus sa place dans un essai que dans un article scientifique. Lâobservation des mĂ©thodes de Vincent de Beauvais et des erreurs de cohĂ©rence dans son ouvrage mâa portĂ© Ă constater une proximitĂ© entre le mouvement des encyclopĂ©distes du XIIIe siĂšcle et le mouvement actuel dâexpansion dĂ©bridĂ©e de lâinformatique et de lâInternet. LâaccĂšs Ă lâinformation Ă©tant devenu encore plus aisĂ© quâauparavant, on observe en effet, en particulier auprĂšs des Ă©tudiants universitaires (nĂ©s avec cette facilitĂ© dâaccĂšs Ă lâinformation), une propension certaine Ă la juxtaposition dâinformations : de nombreux travaux sont souvent une succession dâextraits plus ou moins remaniĂ©s, gĂ©nĂ©ralement tirĂ©s dâouvrages Ă disposition sur le site de Googlebooks, parfois sans aucune considĂ©ration pour le contexte initial des informations, voire sans souci dâhomogĂ©nĂ©itĂ©. Lâanalyse prend ainsi de plus en plus de place, et la synthĂšse sâefface, rompant lâĂ©quilibre entre ces deux facultĂ©s qui est pourtant un des buts les plus importants, sinon le but le plus important des Ă©tudes universitaires. Ce systĂšme mâapparaĂźt en plusieurs points similaire Ă ce que lâon observe dans la dĂ©marche des encyclopĂ©distes du XIIIe siĂšcle : Vincent de Beauvais met en parallĂšle des extraits de texte en les sortant de tout contexte, et propose ainsi des informations brutes, sans donner au lecteur les Ă©lĂ©ments suffisants pour les comprendre pleinement. Faciliter lâaccĂšs Ă lâinformation brute est au centre de leur entreprise. Mais la comparaison sâarrĂȘte Ă cette caractĂ©ristique formelle : les causes, les motivations, les buts et les mĂ©thodes mĂȘme sont diffĂ©rents. Outre la mise Ă disposition dâinformations, le but des encyclopĂ©distes mĂ©diĂ©vaux est de mettre en perspective les anciens savoirs en prĂ©sentant Ă©galement les nouveautĂ©s, de rĂ©colter les dires des plus grandes autoritĂ©s sur tous les sujets pour offrir au lecteur un savoir total ; le souci de cohĂ©rence nâa sa place que dans lâorganisation gĂ©nĂ©rale de lâouvrage, sans oublier lâampleur de la tĂąche.
Annexe en pdf (pp 42-118)
Â